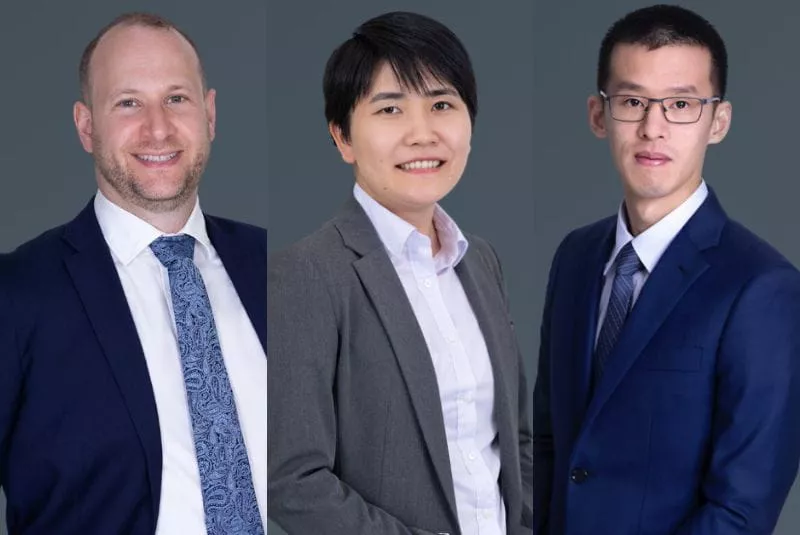La GRC devra payer 1 million $ à une famille

Delphine Jung
2020-12-01 10:15:00

Avec les intérêts et le montant initialement octroyé en Cour supérieure — qui s’élèvent à 700 000 dollars —, le montant total dépasse de peu le million.
Cette décision marque un nouveau revers cinglant pour les autorités fédérales qui ont tenté sans succès d'annuler une décision d'un tribunal inférieur qui les condamnait à payer 426 100 dollars supplémentaires en dommages pécuniaires et moraux au couple et à leurs trois enfants.
L’histoire remonte à 2016, lorsque la GRC, accompagnée de policiers et d’un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada fouillent la maison de Nichan Manoukian et de son épouse Manoudshag Saryboyajian. Ils les soupçonnent de traite de personne.
À la suite de cette enquête, la famille a été accusée pour ce motif. Quelques jours après le dépôt des accusations, une agente de la GRC a émis un communiqué de presse « manifestement faux », selon la Cour d'appel. Les accusations ont été abandonnées en décembre 2007, et en mai 2008, les Manoukian ont intenté une action au civil, une affaire qui a été entendue une décennie plus tard.
En janvier 2018, la juge France Dulude de la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement qui concluait que le procureur général du Canada et les agents de la GRC avaient mené une enquête erronée et leur a ordonné de verser à la famille Manoukian 426 100 dollars. Mais le juge Dulude n'a pas accordé de dommages-intérêts punitifs.
Le juge Dulude a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'un crime avait été commis, compte tenu des preuves dont disposaient les policiers au début de leur enquête, ce qui justifiait la perquisition. Cependant, le juge Dulude a estimé que la GRC a mené une enquête « bâclée » qui avait systématiquement écarté les preuves disculpatoires.
Dans une décision « extrêmement bien motivée », la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal inférieur, et a ajouté à la décision initiale la somme de 400 000 $ en dommages punitifs, pour avoir atteint illicitement et intentionnellement à la réputation des Manoukian.
Au Québec, des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés que dans les cas prévus par l'article 1621 du Code civil du Québec (C.c.Q.). En vertu de l'article 49 de la Charte québécoise, de tels dommages peuvent être accordés en cas d'atteinte illicite et intentionnelle aux droits protégés par la Charte.

« La Charte québécoise est un bon instrument pour stigmatiser la conduite des forces de police par le biais de procédures de droit civil », a déclaré M. Lacroix. « Mais exiger des plaideurs qu'ils prouvent leur intention de nuire semble trop restrictif et souvent les victimes ne peuvent pas obtenir de dommages-intérêts punitifs. La décision de la Cour d'appel a déclaré que l'on peut nuancer cette intention de nuire en adoptant une approche large et libérale. Cette approche donne aux victimes de l'inconduite de la police une plus grande chance d'obtenir des dommages-intérêts punitifs. Il s'agit d'une ouverture », dit-elle encore dans le journal.
Me Julius Grey considère cette décision comme une évolution de la jurisprudence où les tribunaux pourront à l'avenir accorder des dommages-intérêts punitifs même en l'absence de « connaissance absolue » de l'intention.
Selon Me Jean-Claude Hébert, avocat criminaliste, la décision de la Cour d'appel illustre la tension qui règne au sein des tribunaux québécois sur la notion d'octroi de dommages punitifs. De nombreux juges craignent que cela ne conduise à suivre l'exemple des États-Unis, et ont donc « tendance à considérer ce recours avec prudence et retenue ».
Le fait que la GRC a publié de fausses informations tout en le sachant a clairement joué en sa défaveur devant le tribunal.
La Cour d'appel s'est ensuite penchée sur l'évaluation des dommages-intérêts punitifs tels que régis par l'article 1621 du C.c.Q. Parmi les facteurs que la Cour a pris en compte : le fait que la faute a été commise par des policiers agissant en tant qu'agents de l'État, le niveau hiérarchique des personnes impliquées, l'empressement à présenter au public le premier cas de traite des personnes au Canada, etc.
« Ce montant est nécessaire pour assurer l'effet dissuasif souhaité et ainsi éviter la répétition d'une telle bavure policière dans le futur, tout en respectant le principe de modération », a conclu le juge Thibault.
Partager cet article:

 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook