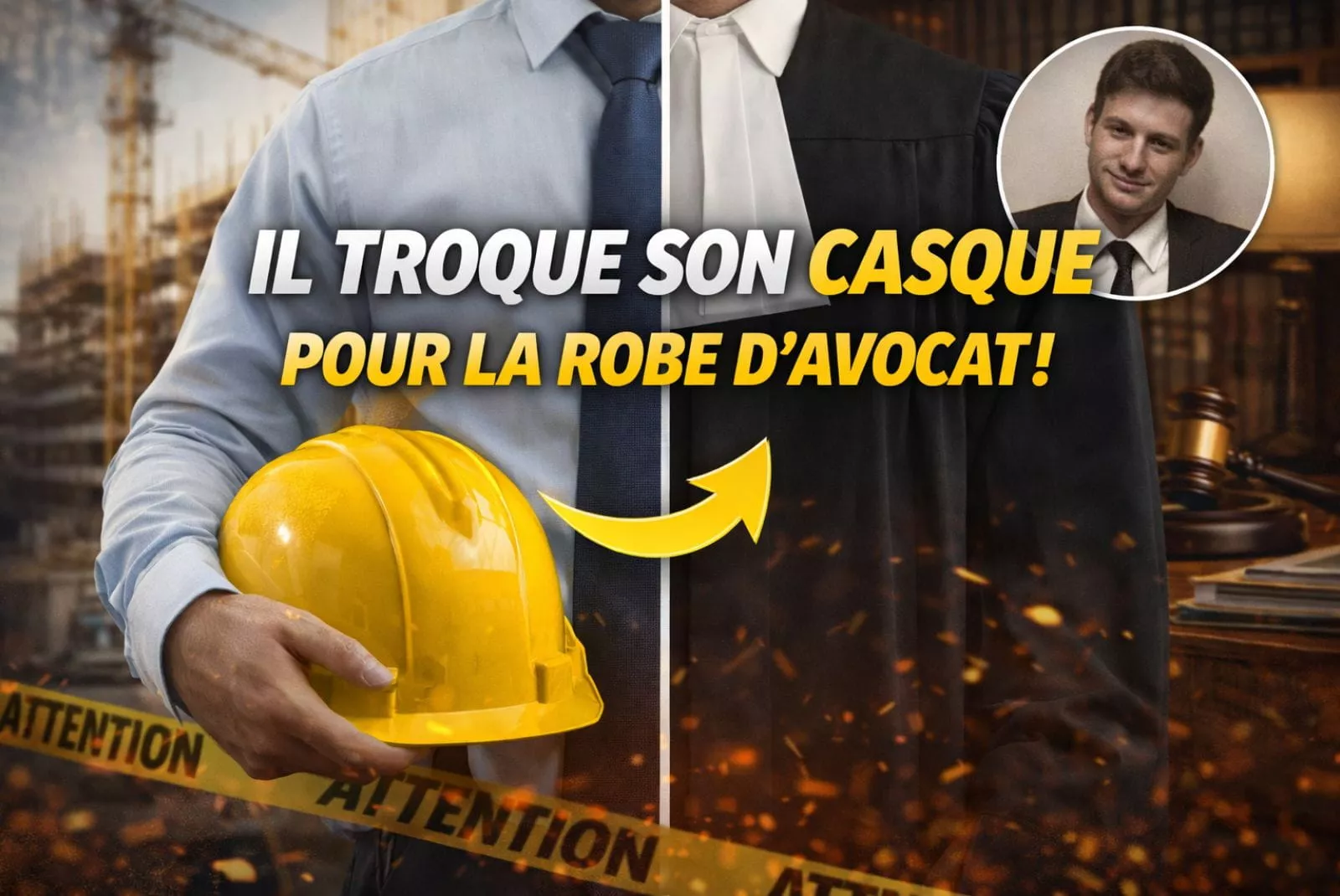La Cour d'appel casse un jugement contre la Ville de Brossard

ans une décision qui fait jurisprudence, la Cour d'appel du Québec rejette une action collective intentée par des citoyens de Brossard contre leur ville.
La Cour d’appel casse un jugement de la Cour supérieure, qui avait autorisé une action collective contre la Ville de Brossard pour une affaire de troubles du voisinage.
L'affaire portait sur les inconvénients — bruit, poussière et vibrations — causés par l'augmentation de la circulation sur le chemin des Prairies.

La décision de la Cour d’appel a été rendue le 13 août pour les motifs de la juge Christine Baudoin, auxquels ont souscrit les juges Benoît Moore et Frédéric Béchand.
L’appelante, la Ville de Brossard, était représentée par Mes Adina-Cristina Georgescu, Roxane Nadeau et Camille Ingarao de Miller Thomson, alors que les intimés, Mohamed Belmamoun et Gaëtan L’Heureux, étaient défendus par Me Marie-Hélène Guilbault, de Gonthier Avocats.
L’Union des municipalités, qui faisait office d’intervenante, était quant à elle représentée par Mes Mathieu Quenneville et Axel Fournier, de Prévost Fortin D’Aoust.
Une route de campagne devenue voie de transit

L'affaire a été portée par un groupe de citoyens, représenté par Mohamed Belmamoun et Gaëtan L'Heureux, qui résident le long du chemin des Prairies à Brossard. Ils alléguaient que l'important développement commercial et résidentiel de la ville, notamment l'aménagement du Quartier DIX30, avait transformé leur rue autrefois tranquille en une voie de transit achalandée.
Ce changement causait selon eux des inconvénients anormaux, pour lesquels la Ville de Brossard devait être tenue responsable en vertu de l'article 976 du Code civil du Québec.
En première instance, la Cour supérieure avait donné raison aux citoyens, condamnant la Ville à leur verser des dommages-intérêts.
La juge Dominique Poulin avait conclu que la circulation excessive constituait bel et bien des troubles de voisinage anormaux et que la Ville ne pouvait pas invoquer l'immunité de droit public, car la preuve ne montrait pas que le volume de circulation était le résultat d'une politique délibérée.
Les positions des parties
La Ville de Brossard, appuyée par l'Union des municipalités du Québec, a fait appel du jugement. Elle a soutenu que la juge de première instance avait commis une erreur en appliquant l'article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
La municipalité a plus particulièrement plaidé que l'augmentation de la circulation découlait de ses décisions de planification et de développement du territoire, qui sont de nature politique, et non de l'exercice de son droit de propriété sur la rue.
La Ville a également invoqué l'immunité de droit public, qui protège les autorités contre les poursuites civiles pour des préjudices résultant de décisions politiques fondamentales, à moins qu'elles ne soient irrationnelles ou de mauvaise foi.
Les citoyens ont pour leur part maintenu que la juge avait eu raison d'écarter l'immunité de la Ville, arguant que le préjudice qu'ils subissaient était le résultat d'un usage de la rue par la Ville qui créait des inconvénients anormaux de voisinage.
Les intimés ont souligné que la Cour suprême, dans l'affaire Maltais, avait déjà reconnu que l'État peut être tenu responsable de troubles de voisinage en tant que propriétaire d'une infrastructure publique.

La décision de la Cour d'appel : un enjeu de droit et non de propriété
La Cour d’appel a accueilli l'appel de la Ville de Brossard et infirmé la décision de première instance. Selon elle, la juge de première instance a commis une erreur de droit en appliquant l'article 976 C.c.Q.
La juge Christine Baudoin a estimé que le régime de responsabilité pour troubles de voisinage ne pouvait pas s'appliquer, car les inconvénients ne découlaient pas d'une manière d'exercer le droit de propriété, mais d'une série de choix de gouvernance.
Autrement dit, la Ville de Brossard a agi en tant qu'autorité publique qui prenait des décisions de nature politique et réglementaire sur le développement, l'aménagement et l'urbanisation de son territoire. Ces décisions, telles que l'aménagement de nouvelles rues, de zones commerciales et résidentielles, ne relèvent pas du simple exercice du droit de propriété, mais de la sphère politique de la municipalité, a tranché la Cour d’appel.
L'immunité de droit public confirmée
Bien qu'elle ait fondé sa décision sur l'inapplicabilité de l'article 976 C.c.Q., la Cour d'appel a également réitéré l'importance de l'immunité de droit public.
La juge Baudouin a expliqué que les décisions de politique générale, comme celles sur l'aménagement du territoire, doivent être protégées de l'ingérence des tribunaux. Principe de la séparation des pouvoirs oblige, les tribunaux ne peuvent pas s'immiscer dans les choix politiques des autorités élues.
Pour la juge Baudouin, l'affaire de Brossard se distingue de l'affaire Maltais. Dans ce dernier cas, la responsabilité du Ministère des Transports du Québec découlait de son inaction en tant que propriétaire d'une autoroute, un manquement directement lié à la gestion de son fonds. Dans le cas de Brossard, les inconvénients n'étaient pas le résultat d'une inaction sur le chemin des Prairies lui-même, mais d'une ligne de conduite générale en matière d'urbanisme.
En somme, la Cour d'appel a statué que la contestation des actes de la Ville devait se faire dans l'urne électorale, et non devant les tribunaux, à moins d'une faute avérée, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.
Droit-inc a tenté de recueillir les commentaires des avocats des parties, mais n’avait pas eu de retour au moment de mettre cet article en ligne.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook