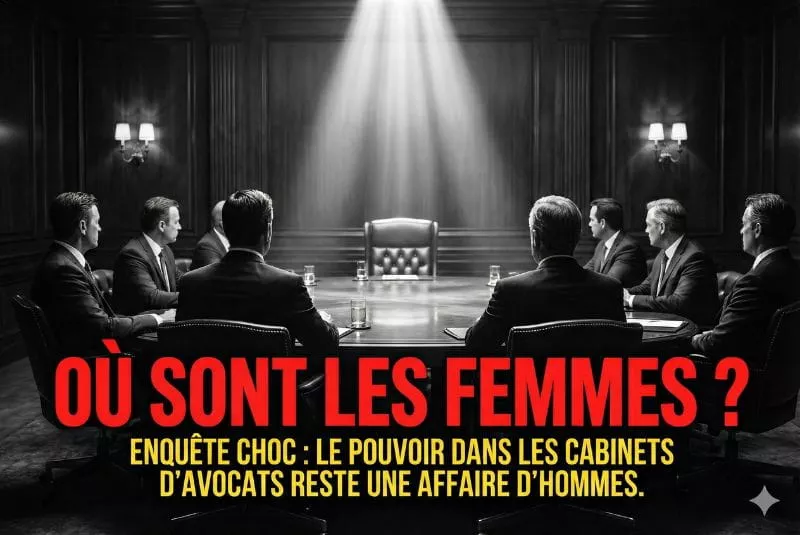Les impacts du jugement en diffamation de « la Métisse » contre une Atikamekwra

Radio Canada
2025-07-07 14:15:31
Isabelle Falardeau, qui se fait appeler « la Métisse », a perdu son procès contre l’artiste et militante atikamekw Catherine Boivin.
Le jugement entre une femme se disant « métisse » et une artiste atikamekw a soulevé les passions ces derniers jours. Au-delà du débat sur l’identité autochtone que l’audience a pu soulever, des experts estiment que le jugement réaffirme la liberté d’expression et donne encore plus de poids à la Déclaration des Nations unies sur les droits de peuples autochtones.
La semaine dernière, la juge Sophie Picard rendait sa décision concernant la cause pour diffamation entre Isabelle Falardeau, dite la Métisse, et Catherine Boivin, une artiste et militante atikamekw. Mme Falardeau estimait que les sorties de Mme Boivin sur les réseaux sociaux à son encontre relevaient de la diffamation. De son côté, Mme Boivin assurait exprimer ses inquiétudes face à ce qu’elle considère comme de l’appropriation culturelle et le mouvement non reconnu légalement des Métis de l’Est.

La juge Picard a rendu une décision en faveur de Mme Boivin. « C’est un jugement très intéressant sur un sujet qui est d'actualité. Il y a différentes communautés qui se battent contre l'appropriation culturelle, de toute sorte, que ce soit par des personnes qui viennent faire des thèses de doctorat ou de maîtrise, et qui demandent d'avoir accès à certaines informations, au nom d’un bénéfice plutôt personnel », estime Marie-Claude André-Grégoire, avocate d’origine innue.
De son côté, Sébastien Brodeur-Girard, professeur de droit à l’École d’études autochtones de l’UQAT, insiste sur les rappels qu’implique cette décision. « (Elle change les choses) au niveau de la perception des gens, des craintes qu’ils pourraient avoir. À la base, la question est de balancer le droit à la protection de sa réputation avec la liberté d’expression. Si des gens ont peur de se faire poursuivre parce qu’ils émettent une opinion, ça peut les amener à se faire poursuivre ».

« Le débat public, sur ces questions-là, doit être protégé », croit aussi M. Brodeur-Girard. Si la question de l’identité de Mme Falardeau elle-même n’était pas au centre du débat juridique – qui portait donc uniquement sur la diffamation –, il a été compliqué d’y échapper lors des audiences.
La juge Picard y est rapidement revenue dans sa décision.
Je pense que ça permet de sensibiliser les gens sur le fait que les communautés autochtones veulent se défendre et nommer les personnes qui se définissent comme Métis ou même comme Indiens non inscrits, sans avoir de preuves, ajoute Mme André-Grégoire. L’avocate innue rappelle que les personnes qui s’autoproclament comme autochtones peuvent créer beaucoup de tort aux communautés autochtones. Elle explique que les Autochtones ont subi et subissent encore les conséquences de la colonisation et qu’ils portent des traumatismes intergénérationnels. De son côté, M. Brodeur-Girard souligne qu’on voit, ces dernières années, une montée des revendications concernant l’identité autochtone.
Il y a eu une montée de gens qui, à tort ou à raison, selon les cas, ont cru pouvoir réclamer des droits. Au Québec, il y a eu de nombreuses personnes dans les tribunaux qui n'ont jamais abouti à une reconnaissance d'une identité métisse, ajoute-t-il.
Selon Mme André-Grégoire, cette décision est intéressante et prouve une fois de plus que le droit autochtone évolue. C’est la beauté du droit autochtone au Canada, dit-elle. D’autant plus, souligne-t-elle, que la juge Picard évoque la Déclaration des Nations unies sur les droits de peuples autochtones (DNUDPA) dans sa décision. C'est une déclaration qui vient protéger notamment l'article 31 sur le patrimoine culturel, le savoir traditionnel. C'est une décision qui est nouvelle, donc importante, et qui n'existait pas encore au Québec, appuie-t-elle.
La DNUDPA a été mentionnée dans d’autres jugements au Canada depuis son adoption par les députés en 2021, ce qui renforce son poids, selon l’avocate, faisant de cette loi un outil législatif maintenant intégré dans le droit canadien.
Ailleurs au Canada, le professeur Darryl Leroux, qui étudie le phénomène des Canadiens français se réclamant d'ancêtres autochtones, est aussi poursuivi en diffamation. La décision n'a pas encore été rendue.
Partager cet article:

 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook