Les sinistrés du Richelieu préparent un recours collectif
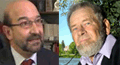
Agence Qmi
2011-09-12 10:15:00
« Les gens ont peur de venir nous visiter. Il suffit qu’il y ait une tempête pour qu’ils fuient, de crainte que le terrain soit inondé », a-t-il dit.

M. Florent a en effet obtenu des documents révélant qu’un projet de barrage destiné à régulariser le cours de la rivière Richelieu avait été mis en branle en 1937 par la Commission mixte internationale, un organisme binational visant à assurer la gestion des plans d’eau situés entre le Canada et les États-Unis.
En 1938, une amorce de barrage a même été construite au coût de 416 000 $ dans la rivière Richelieu, mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale avait entraîné l’interruption du projet.
Un barrage incomplet se trouve donc toujours dans la rivière Richelieu, mais sans utilité.
« Des inondations, il y en a toujours eu dans la région et c’est pour ça qu’on avait le projet de faire ce barrage », a souligné M. Florent, qui estime que les pouvoirs publics ont été négligents depuis cette période en omettant d’exécuter les travaux prévus.
C’est d’autant plus vrai, selon lui, que le gouvernement fédéral n’a jamais renié sa signature sur l’entente ratifiée en 1937. Une lettre datée du 21 février 1975 rédigée par un représentant du ministère des Affaires extérieures du Canada et obtenue par M. Florent assurait plutôt la section canadienne de la Commission mixte internationale que l’entente conclue en 1937 tenait toujours.

Entre 1970 et 1974, les autorités fédérales avaient procédé au nettoyage du Canal Chambly. Cela a eu pour effet de rétrécir la rivière Richelieu et de ralentir son débit, ce qui a accru le risque d’inondations.
M. Florent soutient aussi que le niveau du lac Champlain a été maintenu artificiellement élevé depuis une quinzaine d’années afin de restreindre la prolifération des algues et de favoriser la navigation.
« On comprend que dans la vie de tous les jours, ça peut être une bonne idée, mais quand il y a de fortes précipitations, il ne faut pas beaucoup de choses pour que la situation devienne hors de contrôle », a-t-il expliqué.
Il a dit s’être adressé au Protecteur du citoyen afin de faire valoir son point de vue, mais en vain.
Avant d’engager ses recherches, M. Florent s’est assuré du soutien de centaines de sinistrés ayant subi des dommages à leur propriété.
Coûteux
Dans une éventuelle demande d’autorisation de recours collectif, les sinistrés entendent demander un dédommagement pour les dégâts subis, mais aussi le parachèvement du projet de barrage prévu en 1937.
En 1997, un journal local rapportait que le coût des travaux de canalisation à compléter s’établirait à 97 millions $. « J’aurais du mal à vous dire combien ça coûterait aujourd’hui. Certainement plus de 100 millions $ », a dit M. Florent.
L'Office de tourisme et des congrès du Haut-Richelieu estime les pertes provoquées par les inondations entre 10 et 20 millions $.
Un recours collectif contre le gouvernement fédéral dans le dossier des inondations qui ont frappé de nombreux résidents et agriculteurs dans la vallée du Richelieu au printemps dernier apparaît comme une entreprise audacieuse, mais pas impossible à réaliser.
C’est l’avis de François Lebeau, avocat spécialisé dans les recours collectifs. Selon lui, il faut que quatre grandes conditions soient réunies pour qu’un recours collectif puisse aller de l’avant.
Il faut d’abord qu’un groupe de personnes soit touché par un dommage. L’idée derrière la procédure de recours collectif est de faciliter l’accès à la justice à des personnes qui hésiteraient à s’adresser individuellement aux tribunaux.
Il faut que des éléments en commun rassemblent des personnes touchées. « La différence dans les dommages n’est pas importante, mais il faut être capable de circonscrire de façon assez claire le lieu et le moment où le dommage a été causé au groupe », a expliqué M. Lebeau.
Troisièmement, il doit y avoir une apparence sérieuse de responsabilité. En clair, le recours doit se tenir et ne pas sembler voué à l’échec dès le départ.
Quatrième condition, la personne qui pilote le recours doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate du groupe en étant suffisamment articulée pour exprimer clairement son point de vue devant les tribunaux.
Dans le cas des sinistrés du Richelieu, M. Lebeau estime qu’au moins trois conditions sur quatre semblent réunies. M. Lebeau ne pouvait se prononcer sur la troisième condition, disant ne pas être suffisamment au fait du dossier.
Pour autant, même si les quatre conditions sont réunies, M. Lebeau explique que la partie est loin d’être gagnée pour les sinistrés.
« À première vue, ça me paraît difficile. Le temps n’est pas censé avoir d’influence, mais on doit se demander pourquoi entre 1938 et aujourd’hui il ne s’est rien passé. C’est une question que les opposants au recours vont soulever », a-t-il dit.
M. Lebeau signale aussi qu’il existe une forme d’immunité juridique dans les dossiers impliquant un choix politique. « Si le projet a été stoppé à cause de décisions politiques, je pense que ce sera difficile pour les sinistrés d’obtenir gain de cause », a-t-il expliqué.
Malgré tout, des recours collectifs entrepris dans le passé montrent qu’il est possible de tenir des organismes responsables pour des dégâts causés lors de catastrophes naturelles.
Lors du déluge du Saguenay, en 1997, des sinistrés avaient obtenu un dédommagement d’Abitibi-Consolidated pour un barrage construit par l’entreprise qui avait cédé. Un règlement hors cour était intervenu en 2004.
D’autres cas représentent des présages moins favorables.
Ainsi, toutes les poursuites entreprises par les sinistrés de pluies torrentielles tombées à Montréal à l’été 1987 avaient été rejetées par les tribunaux.
Partager cet article:

 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook

















Anonyme
il y a 14 ans>un projet de barrage destiné à régulariser le cours de la rivière Richelieu avait été mis en branle en 1937
Un projet de barrage sur le Richelieu avait été décrié par des environementalistes, qui y voyaient une menace pour le suceur cuivré, une espèce unique à cette rivière (Bernard Lemaire avait alors répondu que "des espèces, il en disparaît tous les jours et il en renait ailleurs" - http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/memoires/memo182.pdf , note 16 (page9))