La présomption d'innocence dans la cuisine

Véronique Robert
2016-10-26 11:15:00

Bien qu'il serait souhaitable que les citoyens soient plus ouverts, moins prompts à porter sur des accusés des jugements à l'emporte pièce quant à leur culpabilité, et bien qu'il serait souvent important que les médias fassent attention à ce qu'ils véhiculent concernant des accusés ou des suspects, il demeure que le concept de présomption d'innocence ne trouve pas application dans une cuisine quand on papote en ouvrant des huîtres non plus que dans la sphère publique.
Par exemple, dans la sphère privée si une amie vous dit avoir été victime d'agression sexuelle, vous avez le droit de la croire.
Par exemple, dans la sphère professionnelle, une sexologue qui reçoit une cliente se disant victime d'agression sexuelle ne lui dit pas « au nom de la présomption d'innocence, je refuse de vous croire ».
Par exemple, dans la sphère politique, un chef de parti peut décider d'exclure de son caucus une personne suspectée ou accusée d'un crime grave, simplement par prudence et pour assurer la sérénité des débats.
Par exemple, dans le domaine policier, les enquêteurs ne fondent pas leurs démarches sur le fait que le suspect est fort probablement innocent sans quoi aucune enquête n'aboutirait jamais.
Par exemple, en matière d'information, le journaliste peut rapporter qu'une personne est suspecte ou accusée ce qui ne constitue pas une violation de la présomption d'innocence puisque le principe ne s'applique pas à lui.
Même le procureur de la poursuite, qui a le rôle d'autoriser ou de refuser une plainte policière, ne fait pas intervenir la présomption d'innocence dans sa réflexion le menant à porter ou non des accusations.
Au fait, l'avocat de la défense non plus n'a pas besoin de croire son client innocence pour le représenter, il n'a qu'à chérir le principe capital de présomption d'innocence et à travailler pour que jamais personne ne soit condamné tant qu'une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité n'a pas été faite.
Autant d'exemple qui peuvent sembler constituer des accrocs à la présomption d'innocence mais qui ne changent rien au fait que, devant le Tribunal, l'accusé est présumé innocent et que le mode d'analyse du juge se fera selon les mécanismes prévus pour garantir cette présomption d'innocence; cela ne change rien au fait non plus que l'accusé aura droit à un procès juste et équitable et à une défense pleine et entière et qu'il ne sera pas condamné tant que la preuve de sa culpabilité n'aura pas été faite hors de tout doute raisonnable.
En cas de médiatisation :
Évidemment, plus une affaire sera médiatisée -et lorsque qu'une affaire est médiatisée c'est presque toujours en défaveur des accusés sauf en matière d'agression sexuelle- moins il sera facile, si l'accusé choisit un procès devant jury où s'il est obligé d'être jugé par un jury, de trouver des jurés qui n'ont jamais entendu parler de l'histoire ou qui ne se sont pas fait une idée sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Mais c'est une autre histoire.
Tout ça pour dire que le concept juridique de présomption d'innocence n'emporte pas l'interdiction d'avoir, dans la sphère publique, des discussions, des opinions ou des sentiments qui seraient exclus, à juste titre, du cadre d'analyse juridique dans une salle de Cour.
Tout ça pour dire surtout que la présomption d'innocence n'empêche pas une femme de déclarer publiquement avoir été victime d'agression sexuelle, avec les risques que ça comporte pour elle, et si quelque misogyne veut lui imposer de se taire parce que sa voix dérange, qu'il ne le fasse pas au nom de la présomption d'innocence. Faut savoir sortir du schéma cognitif juridique moniste, le contraire fait psychotique.
Le droit des femmes à la dignité
Le débat qui sévit depuis quelques jours fait ressortir l'inexorable affrontement entre les droits fondamentaux des accusés et les droits des femmes à la dignité. C'est un affrontement qui tiraille les juristes depuis des décennies, plus particulièrement les juristes progressistes qui ont fait en sorte que de nombreuses réformes du droit ont eu lieu pour tenter d'équilibrer ces droits.
On pouvait lire Rachel Chagnon dans Le Devoir il y a quelques jours:
« La construction anglo-saxonne du droit criminel qui veut que l’on accorde la présomption d’innocence à l’accusé est quelque chose de précieux. Mais je dois constater — et c’est cruel pour une juriste — que, quand on est dans des matières comme l’agression sexuelle, ce concept si précieux de la présomption d’innocence vient amplifier les préjugés contre la victime. La présomption, additionnée aux préjugés négatifs, fait qu’on en vient à carrément refuser de croire les victimes jusqu’à créer pour elles une présomption de culpabilité. Elles seraient alors coupables de mentir pour faire condamner sans fondement un homme innocent. C’est une déformation de la présomption d’innocence.»
Je suis entièrement d'accord que le principe de présomption d'innocence, mal compris, amène le citoyen moyen à faire des raisonnements boiteux. On y assiste actuellement d'une manière alarmante. Sauf que cela encore devrait rester dans la cuisine. C'est dans la cuisine qu'il faut que ça change pour que ça puisse changer devant la Cour.
On ne peut pas remettre en cause le principe de présomption d'innocence, on ne peut pas alléger le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable, on ne peut pas toucher à un poil du droit à une défense pleine et entière, et on ne peut pas même songer une seconde à remettre en cause l'idée du procès juste et équitable pour l'accusé.
Mais théoriquement, ou techniquement, devant la Cour, la présomption d'innocence de l'accusé, qui est la base de la grille d'analyse du juge, n'emporte une présomption de turpitude de la plaignante.
Par exemple, un-e juge peut très bien croire la plaignante quant au fait qu'elle n'a pas consenti, tout en croyant l'accusé lorsqu'il dit qu'il croyait qu'elle consentait, pour autant que cette croyance soit raisonnable.
Un problème d’abord social
Le problème, comme toujours, est donc d'abord social. Si on réalise, et c'est ce qui arrive présentement, que la culture du viol est omnipotente, et qu'on se fonde sur la présomption d'innocence de l'accusé pour se donner le droit de dénigrer une femme qui dit avoir été violée, on fait un saut entre deux dimensions qui n'a pas lieu de se faire. On fait entrer des préjugés collectifs à l'endroit des femmes dans la sphère juridique alors qu'il a fallu des luttes et des réformes pour que cela n'existe plus.
Il faut faire un constat: ce n'est qu'en matière d'agression sexuelle que, dans la cuisine où l'on papote en ouvrant des huîtres, les personnes qui dénoncent un crime sont traînées dans la boue. A-t-on déjà vu un père dénoncer la mort de son fils se faire répondre «Tais-toi, présomption d'innocence!». Je n'ai pas envie de donner d'autres exemples, ils seraient tous adéquats.
Évidemment que c'est risqué, pour n'importe quel témoin, et encore plus quand un procès reposera uniquement sur la crédibilité, de multiplier les déclarations.
Alors non, je n'ai pas envie de dire à Alice Paquet de se taire, mais évidemment que chacune de ses déclarations est une munition de plus pour l'accusé qui voudra ébranler sa crédibilité comme c'est son droit de le faire.
L’honnêteté : des munitions pour la défense?
Les contradictions sont des munitions pour la défense, mais certains élans d'honnêteté aussi. Aller dire qu'elle a un trouble de la personnalité limite va lui nuire. Et c'est d'autant plus désolant qu'on s'aperçoit ces dernières années que toutes les femmes se font diagnostiquer personnalité limite; que c'est presque une mode d'être une personnalité limite.
Est-ce qu'Alice Paquet s'est contredite, est-ce qu'Alice Paquet a vraiment été escorte, a-t-elle vraiment un trouble de la personnalité limite, a-t-elle ou non eu des points de suture au lendemain de l'incident: on est vraiment en train de faire un procès sur la place publique: le procès d'Alice Paquet.
Or, parmi ces éléments, certains sont absolument sans pertinence juridiquement: le fait qu'elle ait ou non été escorte ne change rien. Faut-il vraiment expliquer en 2016 qu'il est illégal de violer une prostituer. La seule chose qui peut nuire à Alice Paquet, et avec raison malheureusement, c'est de l'avoir d'abord caché.
Parce que les contradictions entre deux versions données par la plaignante ne sont anodines quand la crédibilité est au cœur d'un litige. Si un détail comme la couleur des bas de l'accusé peut sembler risible, une tonne de contradictions qui s'accumulent peuvent donner à un témoignage global un air d'invraisemblance.
Alors non, je n'ai toujours pas envie de sommer Alice Paquet de se taire, mais il est évident qu'avec les proportions que l'affaire prend, la rage qu'elle suscite contre elle, l'empressement qu'on a à vouloir protéger le suspect au nom de la présomption d'innocence en salissant la jeune femme, elle risque inévitablement de dire des choses qui pourraient miner sa crédibilité à la Cour et que, pour reprendre des mots d'Yves Boisvert, la table semble assez bien mise «pour un autre spectaculaire ratage judiciaire».
Mais ce ratage n'est pas entièrement dû au fait qu'Alice Paquet a parlé, il est dû au salissage de sa personne qu'on s'est empressé de faire. Alors ce n'est pas tellement le droit qu'il faut changer, ce sont les mentalités.
La culture du viol par la porte d’en arrière
Parce que le système de justice est composé d'humains qui ne vivent pas en vase clos. Seulement dans la foulée de cette affaire, j'ai entendu deux collègues remettre en cause la crédibilité de la plaignante 1) en raison de l'absence de plainte spontanée (une vieille règle de preuve misogyne abolie depuis des lustres et 2) en raison du fait qu'elle pourrait être retournée voir son agresseur (alors qu'on connaît les innombrables raisons qui peuvent amener une victime d'agression sexuelle à d'abord taire ce qu'elle a vécu).
À croire que la Cour suprême, depuis 1980, a parlé pour rien, même aux avocats.
Non les vieux préjugés à l'égard de la crédibilité des femmes ne devraient pas, théoriquement, se transposer à la Cour, et je ne répudie d'aucune façon ce que je dis plus haut concernant la présomption d'innocence, mais il reste qu'il existe encore, dans la sphère sociale, cette présomption de turpitude de la plaignante, que cette présomption de turpitude ne fait surface que dans les affaires d'agression sexuelle et qu'elle n'est pas autre chose que du slutshaming, intimement lié à la culture du viol.
Or, cette culture du viol risque encore d'être amenée à la Cour par la porte d'en arrière sans que les acteurs ne s'en aperçoivent parce qu'ils sont coincés dedans.
Je conclus donc, vu la ruée à laquelle on assiste actuellement, qu'il y aurait peut-être effectivement lieu de se taire et d'attendre que s'entament les procédures judiciaire avant que les dégâts deviennent indélébiles.
Elle est également chargée de cours en droit criminel à l’Université Laval et a été successivement avocate recherchiste à la Cour d’appel (2000-2002), procureure de la Couronne au Bureau de la lutte au crime organisé (2002-2004) puis avocate à la Commission d’enquête Gomery (2004-2005).

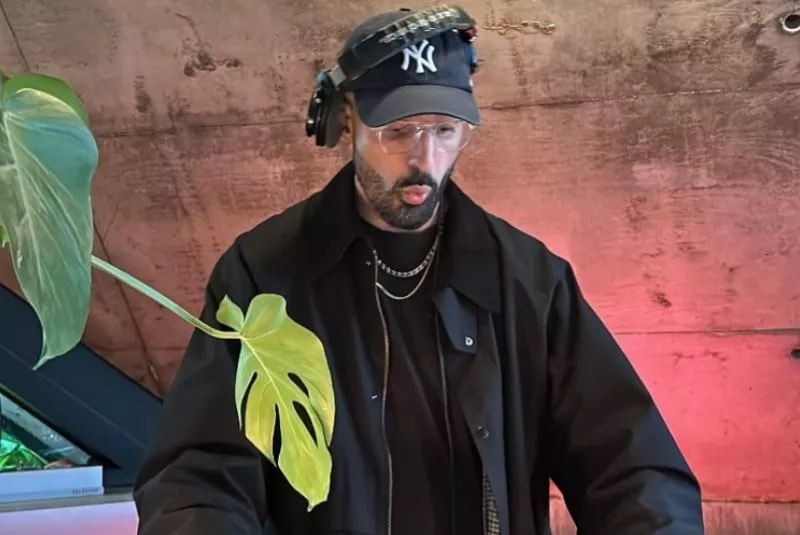










Anonyme
il y a 9 ansUne petite question banale...ne serait-il pas souhaitable que les medias et surtout les parties concernées puissent laisser le judiciaire faire son travail AVANT d exposer le point de vue détaillé de chaque protagoniste, qui inévitablement va finir par se contredire d une fois a l autre devant les cameras? Ca eviterait de detruire les reputations et la credibilité de tous un chacun(e). Une fois qu on sait que Y poursuit X pour tel chef, peut etre que se limiter au fameux "pas de commentaires" éviterait tous ces dérapages? APRES un verdict si tu veux passer a Denis Leveque, que tu sois d accord ou non d un coté comme de l autre avec ce verdict, au moins le citoyen ordinaire pourrait évaluer la crédibilité de ce que se dit publiquement en ayant en contexte ledit verdict.
Me semble que ca éviterait a bien du monde de se mettre le pied dans la bouche. Et ca protegerait tant les accusés que les victimes durant la période ou les faits font l objet d un proces. Elle est ou l urgence de faire le proces avant le proces sur la place publique? Plus souvent qu autrement, ca se retourne contre la présumée victime qui n est pas encadrée correctement a ce stade la des procedures. Sans parler de la reputation du présumé agresseur qui sera détruite meme en cas d acquittement.
Si on est une personnalité publique, on peut se retirer si on peut temporairement, si c est pertinent dans l exercice dss fonctions et on attend l issue de la plainte. Y a des moyens de gérer ca plus intelligemment me semble. Et si on n est pas une personnalité publique me semble que rien ne presse a se jeter dans la fosse aux lions mediatique...a moins qu on veule a tout prix voir sa crédibilité détruite a la TV? Des kardashian on en a pas deja assez?
Anonyme
il y a 9 ansEt 3) elle a changé de versions à plusieurs reprises déjà.
An Nonyme
il y a 9 ans2) en raison du fait qu'elle pourrait être retournée voir son agresseur (alors qu'on connaît les innombrables raisons qui peuvent amener une victime d'agression sexuelle à d'abord taire ce qu'elle a vécu).
La réponse entre parenthèse ne supporte en rien l'énoncé précédent.
SBS
il y a 9 ansJe ne comprends pas cette tendance à déballer les agressions sur la place publique sans qu'il y ait eu d'abord des accusations. Quel est le but de ces allégations? Fais de cette façon, je pourrais comprendre: "Écoutez, j'ai subit une agression dans le passé, je n'ai pas dénoncé cette agression à la police et je le regrette. Je suis présentement en thérapie avec un psychologue pour tenter de passer au travers cette épreuve et il se peut que je décide de dénoncer à la police. Merci de m'avoir écouté."
la jeune Alice, comme plusieurs autres personnes ayant subit des agressions choisissent de dénoncer leur agression par la voie médiatique. Elles semblent, de plus, vouloir à tout prix voir leur agresseur pendu sur la place publique et être traitée comme l'ultime victime pour pouvoir utiliser cet événement comme la cause de tous leur maux. Il est vrai que ce faisant, la sympathie et les fleurs arrivent rapidement. Un baume sur la plaie. Mais qu'arrive-t-il par la suite? Des pots, des tonnes de pots de fleurs et ces pots là, ils font mal en maudit.
à toutes les victimes, s.v.p. commencez par dénoncer à la police, prenez ensuite toute l'aide que l'on peut vous offrir et gardez vos sorties publiques pour après le procès. Imaginez:
"Salut la gang, j'ai été agressé, j'ai dénoncé, j'ai gagné mon procès et mon agresseur est en prison. Faites comme moi, dénoncé aux bonnes personnes".
Myself
il y a 9 ansAvec l’affaire Gomeshi, j'ai cru que tout le monde avait bien compris qu'un procès de cette nature se gagne en cour et pas dans les médias. Au nombre des victimes au départ, avec le cirque médiatique que cette affaire a connu, le monde était convaincu que le débat se résumerait à la sentence de l’accusé. Au final, cela s’est conclu avec 2-3 victimes et un jugement où les personnes critiquées étaient lesdites victimes notamment à cause de leurs nombreuses déclarations contradictoires. Le juge a pris bien soin de souligner qu’il ne pouvait pas dire qu’il n’y avait pas eu agression sexuelle, mais que les déclarations contradictoires des victimes rendaient impossible pour lui rendre une sentence contre l’accusé. Le juge n’a même pas retenu les années passées avant la dénonciation contre les victimes, reconnaissant que chacun réagit a son propre rythme, il n’a même dit que recontacter après les agressions l’accusé jouait contre elles, non!!! Ce qu’il a sanctionné, c’est le mensonge et ce mensonge il l’a lu dans les différentes déclarations des victimes.
Là, j'ai cru qu'on avait tous compris: quand on est une victime, quand on est prête à dénoncer, même s’il s’est écoulé des années, même si on a revu son agresseur après coup, à partir du moment où on se sent prête, on rencontre les autorités, on dit toute la vérité et on collabore avec lesdites autorités sans cachette, ni mensonge.
On est loin de là : on commence par dénoncer dans les médias et les réseaux sociaux: tribunal populaire par excellence,on se contredit d'un média à l'autre, on se surprend de la réaction dudit tribunal populaire qui lui, ne se soucie pas de présomption d’innocence et qui n’emporte pas condamnation ou acquittement du vrai tribunal, et on prend son temps à rencontrer les enquêteurs.
Je sais pas mais moi, j’y comprends plus rien!!!
incompertusx
il y a 9 ansJe n'accepte pas qu'on dit que nous vivons dans une culture du viol. En Inde, il y a une culture du viol- une femme peut se faire violer dans l’autobus avec une barre de fer par un groupe des hommes et c'est considéré normal. Les gens se sont fait condamner pour ça – ç’a bouleversé la société. Au Québec, il n’y a PAS de culture du viol. La société ne pense pas que le viol c'est normal, comme en Inde.
Les viols sont rares en comparaison avec les pays où il y a une vrai culture de viol. Ça doit être insultant pour ces gens-là qui rêvent pouvoir vivre comme ici de lire ça.
C’est un peu comme lorsque Pauline Marois propose des tests de Français avant de pouvoir voter aux élections - on s’est mis à la comparer à une Nazi. Les Nazis n’ont pas imposé un test de langue – ils ont tué 6M juifs. So please, non, Pauline n’est pas une Nazi et on n’est pas ici en culture du viol, ok.
Ça m'amène à parler de la présomption d'innocence. OUI, justement, il n'y en a pas dans les médias. Une allégation de viol ou même d'inconduite sexuelle peut ruiner la vie d'un homme (pas d'une femme en passant). Ce n'est pas vrai que les victimes ne reçoivent pas assez de sympathie dans les médias - à mon goût, elles en ont beaucoup TROP. Pour moi, c'est beaucoup plus problématique lorsque la société se met à lyncher une personne accusée et présumée innocente que lorsqu'on prend les distances par rapport aux allégations qu'on trouve louches, douteuses, imprécises, voire contradictoires.
Je suis désolé, la présomption d'innocence peut-être non, mais la liberté d'expression ça va de deux bords. S'il y a des médias qui vont tenter de détruire la réputation de l'accusé, il y en a d'autres qui vont mettre en doute la version des victimes. Je suis désolé si ça ne fait pas affaire de toutes les féministes (qui ne chialent pas pourtant contre les premiers), mais ça fait partie des principes fondamentaux de notre société.
Une parenthèse, des cas de VC à la Cour municipale sont jugés en procès sommaire et s'apparentent davantage aux petites créances qu'à un procès criminel. Toute action en divorce avec un avocat $%#$ commence par une plainte de VC à la police. Le mec est presque systématiquement expulsé de sa maison, il perd la garde des enfants et le statut-quo. Ça m'amène à mon autre point. La VC est certes un fléau de société, mais les femmes, elles aussi mentent et sont incentivées à le faire. Le système rend le mensonge facile, profitable, impuni et surtout rationnel.
Anonyme
il y a 9 ansC'est effectivement très triste de voir des juristes, pour qui les mots devraient pourtant avoir un sens, reprendre à leur compte des expressions à la mode et vides de sens comme "culture du viol". Mettre en doute la véracité des allégations ou encore la crédibilité d'une personne qui se dit victime d'agression sexuelle lorsque ce doute est parfaitement légitime, ce n'est pas du slut shaming ou une conséquence de la culture du viol. C'est tout simplement la rationalité en action.
Parajuriste
il y a 9 ansCulture du viol? Non, je n'y crois pas. Culture des expressions-valise, culture de l'enflure verbale, culture de la bonne conscience et de la rectitude politique, on en est plus là actuellement dans notre belle société...
Une fille qui se bat contre le système
il y a 8 ans"Même le procureur de la poursuite, qui a le rôle d'autoriser ou de refuser une plainte policière, ne fait pas intervenir la présomption d'innocence dans sa réflexion le menant à porter ou non des accusations."
Vous direz ça à la procureure qui m'a dit que j'ai couru après, parce que j'ai accepté d'héberger mon ex le temps qu'il retombe sur ses pattes.