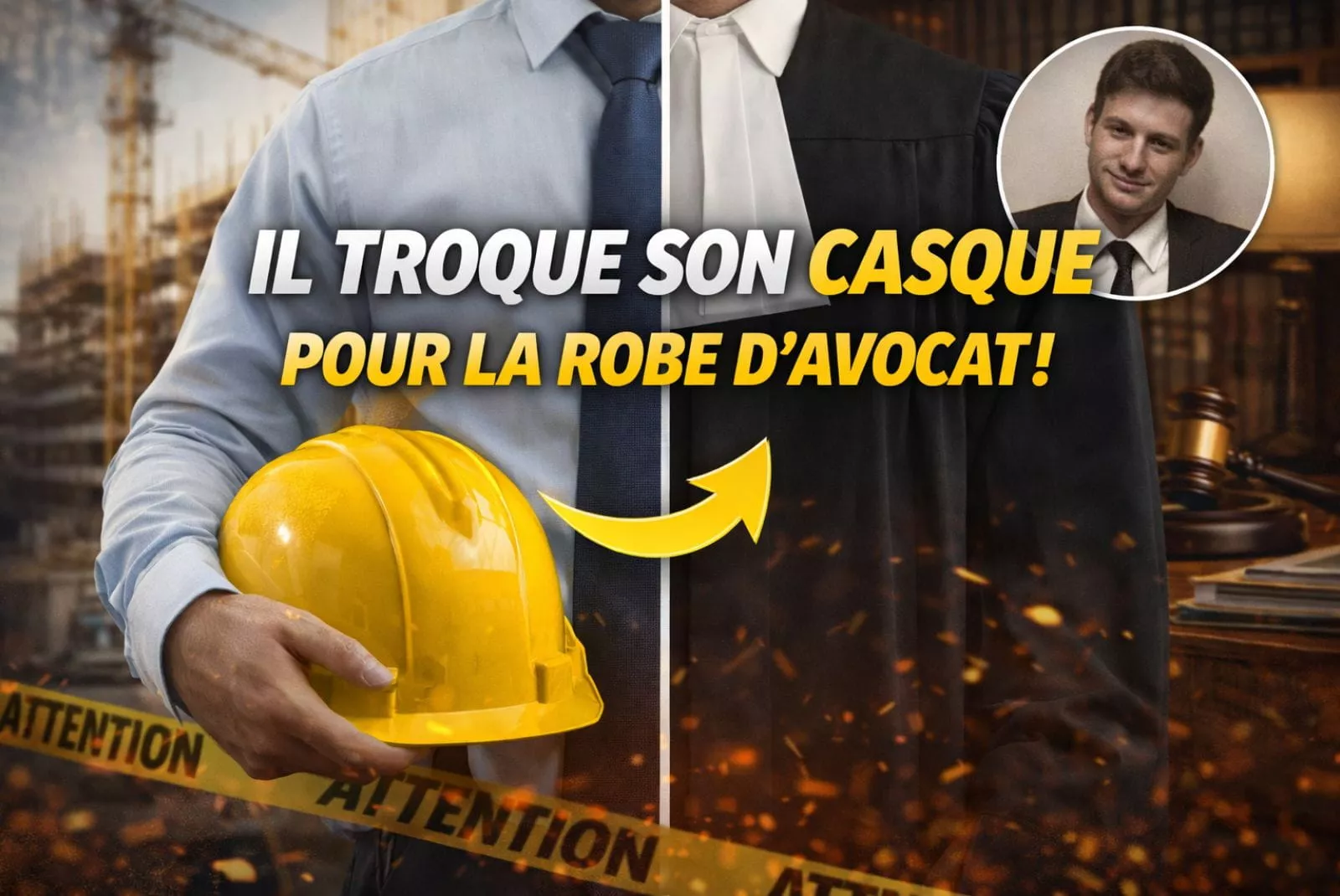Ils manquent à leur devoir de compétence, mais…
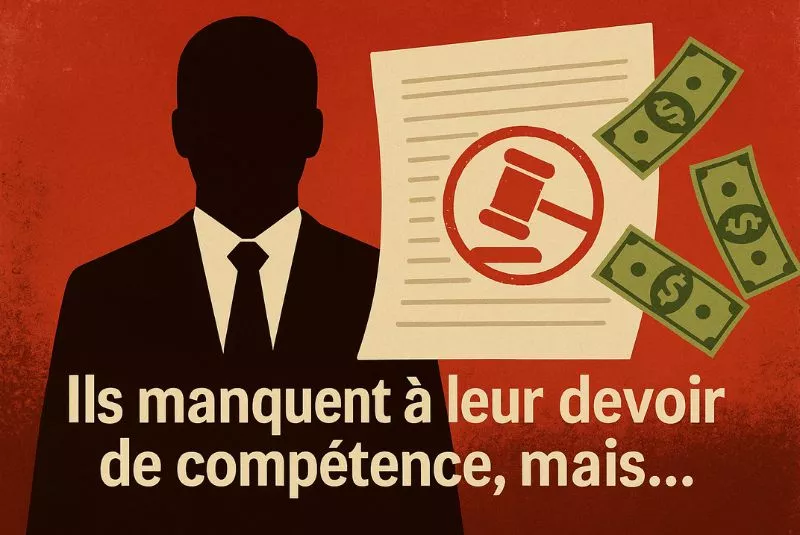
Un devoir de conseil mal avisé a-t-il coûté une fortune à deux héritiers? La Cour supérieure se prononce…

La Cour supérieure tranche dans la poursuite d’héritiers contre leurs anciens avocats, accusés d'avoir mal conseillé leurs clients dans une affaire de succession internationale.
Les fils d’un Québécois d’origine domicilié et mort en France n’ont pas été correctement avisés de leurs droits par leurs anciens avocats, qui ont manqué à leur devoir de compétence et de conseil, a convenu la Cour supérieure dans une récente décision, sans toutefois accueillir leur recours.
Les demandeurs, feu Daniel et feu François Pérusse, ainsi que les demandeurs en reprise d’instance, Marie Domergue, Catharina Christiane Pérusse, Dimitri Pérusse, Hervé Pérusse et Sacha Pérusse, poursuivaient Me Anthony Freiji, le cabinet Schneider Avocats et leur assureur, le Fonds d’assurance professionnelle du Barreau du Québec.

Les défendeurs étaient pour leur part représentés par Me Luc Séguin, de Timmons Séguin Tremblay.
Les demandeurs reprochaient à leurs anciens avocats d’avoir violé leur devoir de conseil dans le cadre d’une dispute en lien avec la succession de leur père, décédé en France en 2016.
Ils leur reprochaient de ne pas les avoir correctement avisés de leurs droits, et plus particulièrement de n’avoir pas réalisé que si le litige était soumis aux tribunaux québécois — plutôt qu’aux tribunaux français, où des procédures étaient déjà pendantes —, ils auraient eu de meilleures chances de faire reconnaître leur droit à l’attribution d’une « réserve héréditaire » représentant les deux tiers de la succession, résume-t-on dans la longue décision du juge de la Cour supérieure Patrick Ferland.

Les demandeurs ont plaidé qu’en raison des mauvais conseils des défendeurs, ils ont dû se contenter d’un règlement bien moins avantageux que ce que la Cour supérieure du Québec leur aurait octroyé.
Le contexte
Au coeur du litige: la présence de deux documents contradictoires, soit le testament québécois de 1987 de Noël Pérusse qui laissait 80 % de ses biens à sa seconde épouse, Nicole Baillargeon, et 20 % à ses deux fils issus d'un premier mariage, et une donation à cause de mort faite en France en 1992 qui accordait l'entièreté de sa succession à sa conjointe.
Les enjeux étaient de taille. En vertu du droit français, qui prévoit une réserve successorale, les fils auraient eu droit aux deux tiers de l'héritage, peu importe les dispositions testamentaires. Au contraire, le droit québécois ne reconnaît pas cette réserve, ce qui aurait limité leur part à 20 % tel que prévu au testament de 1987.
La positions des fils et de l’épouse
Les fils Pérusse soutenaient que la succession devait être régie par le droit français, en raison de la résidence de leur père en France au moment de son décès. Ils ont d'ailleurs initié des procédures judiciaires dans ce sens devant un tribunal français. Ils ont par la suite retenu les services de l'avocat québécois Anthony Freiji pour s'occuper du volet québécois de la succession, notamment pour s'opposer à la vérification du testament québécois. Leur objectif était clair : suspendre les procédures au Québec en attendant que le tribunal français ne se prononce.
Nicole Baillargeon arguait pour sa part que le droit applicable était celui du Québec. Son notaire français a invoqué le Règlement européen sur les successions, qui permet de choisir la loi de sa nationalité. Selon lui, la rédaction du testament québécois en 1987 impliquait un choix tacite de soumettre la succession au droit québécois. Elle a donc entrepris des démarches pour faire vérifier le testament au Québec.
La négociation et le revirement
Alors que les parties se préparaient à un long et coûteux litige dans deux juridictions, des discussions de règlement à l'amiable ont été entamées. Les fils Pérusse, conseillés par leurs avocats québécois et français, ont finalement accepté une offre de Mme Baillargeon, s'entendant pour recevoir 100 000 € chacun en échange du retrait de leurs démarches judiciaires.
Cependant, alors que les dernières modalités de l'entente étaient finalisées, Daniel Pérusse a consulté un professeur de droit en succession qui lui a fait réaliser qu'un tribunal québécois, en vertu de ses propres règles de conflit de lois, appliquerait le droit français en se basant sur la résidence du défunt. Convaincu que cette information changeait radicalement l'issue du litige, Daniel Pérusse a soudainement décidé de se retirer de la transaction.
Entente homologuée
Mme Baillargeon n'a pas voulu en démordre et a déposé une demande d'homologation de la transaction devant la Cour supérieure du Québec. La juge Chantal Corriveau a tranché en sa faveur, concluant qu'un accord de principe avait été conclu le 14 février 2017 et que toutes les difficultés subséquentes avaient été résolues par un accord final le 15 juin 2017.
La Cour a statué que, au moment où la transaction a été conclue, les parties étaient pleinement conscientes des enjeux et avaient choisi de régler leurs différends en dehors des tribunaux. Le fait qu'une des parties ait changé d'avis après avoir reçu une nouvelle opinion légale n'invalidait pas l'entente signée le 4 octobre 2018.
La juge a donc homologué l'accord, forçant les fils à accepter les termes négociés.
La poursuite contre Me Freigi et le cabinet Schneider
Un peu plus d'un an après l’accord de 2018 avec Mme Baillargeon, les demandeurs ont intenté une action en justice contre Me Freiji, le cabinet Schneider Avocats et leur assureur.
Les demandeurs accusaient Me Freiji de négligence et d'incompétence, affirmant qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire pour ce type de dossier et qu'il n'avait pas vérifié le droit applicable à la succession, supposant à tort que le droit québécois s'appliquait.
Initialement, les demandeurs réclamaient 800 000 $ en dommages pour la perte de leur part d′héritage, 39 249 $ en honoraires d'avocats et 40 000 $ pour stress et inconvénients. Ce montant a depuis été révisé à 674 293 $, incluant la perte de l'héritage, le remboursement des honoraires et les dommages non pécuniaires.
Les défendeurs ont pour leur part nié avoir commis quelque faute. Ils ont soutenu que leur mandat était en tout temps limité à s’opposer aux procédures de vérification du testament et que les demandeurs ne leur ont jamais demandé de les conseiller.
Ils ont également plaidé l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages réclamés. Pour eux, il est au mieux hypothétique que les tribunaux québécois auraient accepté de se saisir du litige et d’imposer le respect de la réserve successorale du droit français.
Les défendeurs ont du reste argué que les demandeurs n’avaient pas fait la preuve de leurs dommages, au premier chef celle de la valeur de la succession de leur père.
La décision du tribunal
Selon la Cour supérieure, les demandeurs ont raison quant au fait que les défendeurs ont manqué à leur devoir de compétence et de conseil, mais ils n’ont pas démontré qu’ils auraient obtenu un résultat plus favorable en l’absence de faute de leur part.
« Dans le cadre du litige certainement très personnel qui les opposait à l’épouse de leur défunt père, les demandeurs ont été mal conseillés. Alors qu’ils se présentaient comme des spécialistes du droit successoral, leurs avocats n’ont pas su interpréter et appliquer correctement les dispositions pourtant claires du Code civil du Québec », convient le juge Patrick Ferland.
« Les demandeurs n’ont toutefois pas fait la preuve qu’ils en seraient arrivés à un résultat plus favorable s’ils avaient été pleinement informés de l’état du droit », conclut néanmoins le juge avant de rejeter leur recours.
Une faute à relativiser
Le tribunal prend toutefois soin de replacer la faute des défendeurs dans son contexte. Leur mandat était limité et précis, et les instructions reçues ne leur demandaient pas expressément d’envisager ce qui se produirait si les tribunaux québécois étaient saisis du fond de la succession. Quelques jours à peine après la signature de la convention d’honoraires, les demandeurs leur avaient demandé d’explorer une entente à l’amiable, ce qui a laissé peu de temps pour réévaluer la stratégie initiale. Ces éléments, souligne le juge, ne suffisent pas à effacer la faute, mais ils « en relativisent l’ampleur ».
Le procureur des défendeurs a préféré ne pas commenter cette décision. Les avocats des demandeurs n’avaient pas donné suite à notre courriel au moment de mettre en ligne cet article.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook