Placement syndical : la Cour d’appel tranche

La période d’inhabilité de cinq ans imposée à trois dirigeants syndicaux ne viole ni la liberté d’association ni les garanties contre les traitements cruels et inusités…
La Cour d'appel confirme la validité constitutionnelle de la peine d'inhabilité de cinq ans imposée à trois représentants syndicaux coupables de référence illicite de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction.

Les appelants étaient Yves Beaupré, de la Fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité (FIPOE), Marcel Duchesne, de la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers (section locale 9), et Evans Dupuis, de l’Union des opérateurs de machinerie lourde, division des grutiers (local 791G). Les trois syndicats sont affiliés à la FTQ-Construction.
Ils étaient représentés par Me Claude Tardif, du cabinet Rivest Schmidt, et par Me Catherine Massé-Lacoste, avocate senior pour la FTQ-Construction.
La position du Procureur général du Québec, l’intimé, était défendue par Me Bruno Deschênes (Bernard Roy) ainsi que par Mes Caroline Renaud et Gabrielle Saint-Martin-Deaudelin (ministère de la Justice).
Me Marie Pierre Létourneau représentait le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le mis en cause.

L'affaire prend sa source dans la refonte en profondeur de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (Loi R-20) en 2011, notamment par l'adoption de la Loi 30.
Le contexte historique de l'industrie, marqué par des conflits, de l'intimidation, et des abus liés au placement syndical, a forcé le législateur à agir. Cette réforme visait à assainir les relations de travail en abolissant le placement syndical au profit d'un Service de référence de main-d’œuvre administré par la Commission de la construction du Québec (CCQ).
L'article 119.0.1 de la Loi R-20 criminalise la référence de main-d'œuvre en dehors de ce service légal. L'article 119.11, au cœur du litige, prévoit qu'une personne déclarée coupable de cette infraction est inhabile à diriger ou à représenter une association syndicale visée pendant une période de cinq ans.
Les appelants Marcel Duchesne, Evans Dupuis et Yves Beaupré ont tous été déclarés coupables d'avoir fait de la référence interdite de main-d'œuvre.
En ce qui concerne Marcel Duchesne, représentant syndical des charpentiers-menuisiers, les événements remontent à mars 2014. Après avoir échoué à contacter le propriétaire de Construction Germain inc., il s’est rendu sur le chantier, où il a fortement recommandé l'embauche d'un travailleur spécifique, Raymond Bolduc, ce que l’employeur a refusé.
Le représentant est revenu plus tard et a confronté le propriétaire avec agressivité. À la suite de cette altercation, M. Duchesne a menacé de revenir avec du renfort de la FTQ. Deux jours plus tard, il s'est présenté sur le chantier accompagné de deux collègues, incitant M. Germain à l’accuser de faire du placement illicite.
L'accusation contre Evans Dupuis, directeur de l’Union des opérateurs grutiers, concerne des événements survenus en Gaspésie en janvier 2014. Des travailleurs locaux bloquaient un chantier pour revendiquer leur droit de travailler à la place de l'équipe venue de Montréal.
Le président de l'entreprise Les Grues JM Francoeur inc. a contacté M. Dupuis pour obtenir de l'aide. M. Dupuis lui a conseillé de favoriser l’embauche de main-d’œuvre régionale.
L'employeur est passé par le Service de référence de la CCQ, mais M. Dupuis a fourni le nom d’un travailleur régional à un collègue qui détenait un permis de référence. C'est ce contournement du processus légal qui lui a valu une déclaration de culpabilité.
Quant à Yves Beaupré, représentant syndical pour la FIPOE, les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés à l’automne 2014 lors d'une rencontre avec l'employeur Lambert Somec inc. concernant la nomination d’un délégué de chantier.
M. Beaupré et un collègue ont communiqué le nom d'un électricien qu’ils jugeaient apte pour le poste de délégué, alors qu’ils savaient que l'employeur devait obligatoirement passer par le Service de référence de la CCQ pour toute recommandation d'ouvrier. Ce geste a été jugé comme une référence interdite de main-d'œuvre.
Les positions des parties
Les appelants soutenaient que l'inhabilité de cinq ans portait atteinte à leur liberté d'association garantie par les Chartes canadienne et québécoise, notamment dans sa dimension « constitutive » (le droit de choisir ses représentants).
Ils plaidaient également que cette inhabilité constituait une peine ou un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la Charte canadienne.
L’intimé, le Procureur général, défendait la disposition législative, affirmant qu'elle était une mesure nécessaire pour garantir l'intégrité du système de référence de main-d'œuvre et pour assurer la probité des représentants syndicaux, en vue de mettre fin à une longue histoire d'abus dans l'industrie.
Le jugement de première instance
Dans sa décision rendue le 14 novembre 2023, le juge de la Cour supérieure Éric Dufour a d'abord examiné l'argument selon lequel l'inhabilité de cinq ans violait la liberté d'association garantie par les Chartes.
Les appelants soutenaient que le droit de choisir leurs représentants, une dimension fondamentale de la liberté d'association, était absolu et ne tolérait aucune entrave. Ils affirmaient que la loi leur interdisait d'élire des personnes de leur choix.
La Cour supérieure a rejeté cette interprétation. Elle a conclu que le droit de choisir des représentants n'inclut pas le droit de déterminer leurs conditions d'éligibilité ou de probité. Le juge Dufour a insisté sur le fait que le législateur a le droit de fixer des règles de conduite minimales pour les dirigeants syndicaux.
Surtout, le juge a rappelé le contexte historique de l'industrie, marqué par l'intimidation et la violence. Il a noté que le placement syndical était la source principale de ces problèmes et que la loi avait été adoptée pour assurer l'intégrité du système de référence de main-d'œuvre.
Pour le juge de la Cour supérieure, l'inhabilité de cinq ans ne crée aucune entrave substantielle à la liberté d'association. La mesure ne prive pas les travailleurs de leur capacité à négocier collectivement ou à élire leurs représentants selon les règles internes du syndicat, l'objectif étant simplement de garantir que les représentants soient au-delà de tout reproche, a fait valoir le juge Dufour.
De manière subsidiaire, le juge a précisé que même s'il y avait atteinte à la liberté d'association, elle serait justifiée par l'objectif important de rétablir la paix et la probité dans l'industrie de la construction.
Le juge a ensuite analysé l'argument selon lequel l'inhabilité constituait une peine ou un traitement cruel et inusité. Il a déterminé que cette sanction n'était pas une peine de nature « pénologique », mais une sanction civile visant la probité.
Même en la considérant comme un traitement, l'inhabilité de cinq ans n'était ni cruelle ni inusitée, a conclu le juge Dufour. Selon lui, la mesure était proportionnelle aux gestes commis.
Le juge a aussi estimé que cette mesure était tolérable pour la population, étant donné le long historique de troubles et de violence que le législateur tentait d'endiguer. Il a donc rejeté les pourvois en contrôle judiciaire.
Trois questions devant la Cour d’appel
Devant la Cour d’appel, les appelants ont soulevé trois questions :
- La Cour supérieure a-t-elle eu tort de juger que la sanction d'inhabilité de cinq ans ne violait pas la liberté d'association des syndiqués et de leurs dirigeants?
- Si une atteinte à la liberté d'association avait été démontrée, la Cour supérieure a-t-elle eu tort de juger que cette atteinte était néanmoins justifiée par l'objectif de la loi, conformément aux Chartes?
- La Cour supérieure a-t-elle eu tort de conclure que l'inhabilité de cinq ans ne constituait pas une peine ou un traitement cruel et inusité?
La décision de la Cour d'appel
Concernant la liberté d'association, la Cour d’appel a reconnu que le juge de première instance avait commis une erreur technique en limitant l'analyse à la dimension fonctionnelle (négociation collective) plutôt qu'à la dimension constitutive (choix des représentants) de cette liberté. Cette erreur n'a cependant pas été jugée déterminante par les juges Dutil, Gagné et Immer.
La Cour d’appel a appliqué le cadre d'analyse de la Cour suprême (Société des casinos), qui exige de démontrer une entrave substantielle aux activités protégées. Elle a conclu que l’inhabilité à diriger ne constituait pas une entrave substantielle à la liberté d'association, la mesure étant considérée comme légitime dans le contexte visant à assurer la probité syndicale.
Les trois juges ont donc confirmé que la disposition législative ne portait pas atteinte à la liberté d’association.
Puisque la Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté d'association, elle n'avait pas à se prononcer sur la justification au sens de l'article 1 de la Charte canadienne.
Néanmoins, la Cour d'appel a souscrit à l'analyse de la Cour supérieure sur le contexte législatif et historique. Elle a réaffirmé l'importance d'examiner l'historique des relations de travail au Québec qui a mené à l'adoption de la Loi 30, soutenant implicitement que l'objectif législatif était impérieux car il visait à corriger des torts sociaux graves et bien documentés (violence, intimidation, corruption).
Enfin, la Cour d’appel a confirmé la conclusion de la Cour supérieure sur l'article 12 de la Charte canadienne. Elle a d’abord conclu, tout comme le juge de première instance, que la sanction d'inhabilité n'était pas une peine au sens pénal du terme. Elle a aussi statué, à l’instar de la Cour supérieure, que même si elle était considérée comme un « traitement » au sens large, les appelants n’ont pas réussi à démontrer qu'elle franchissait le seuil de la disproportion exagérée requis pour être qualifiée de cruelle et inusitée.
En maintenant cette sanction, la Cour d'appel a réitéré que la mesure est proportionnelle à la gravité des gestes, qui minent directement l'intégrité du nouveau système de référence de main-d'œuvre et le bon fonctionnement de l'industrie de la construction.
Droit-inc a tenté d’obtenir les commentaires des avocats des appelants, mais n’avait pas eu de retour au moment de mettre cet article en ligne.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook
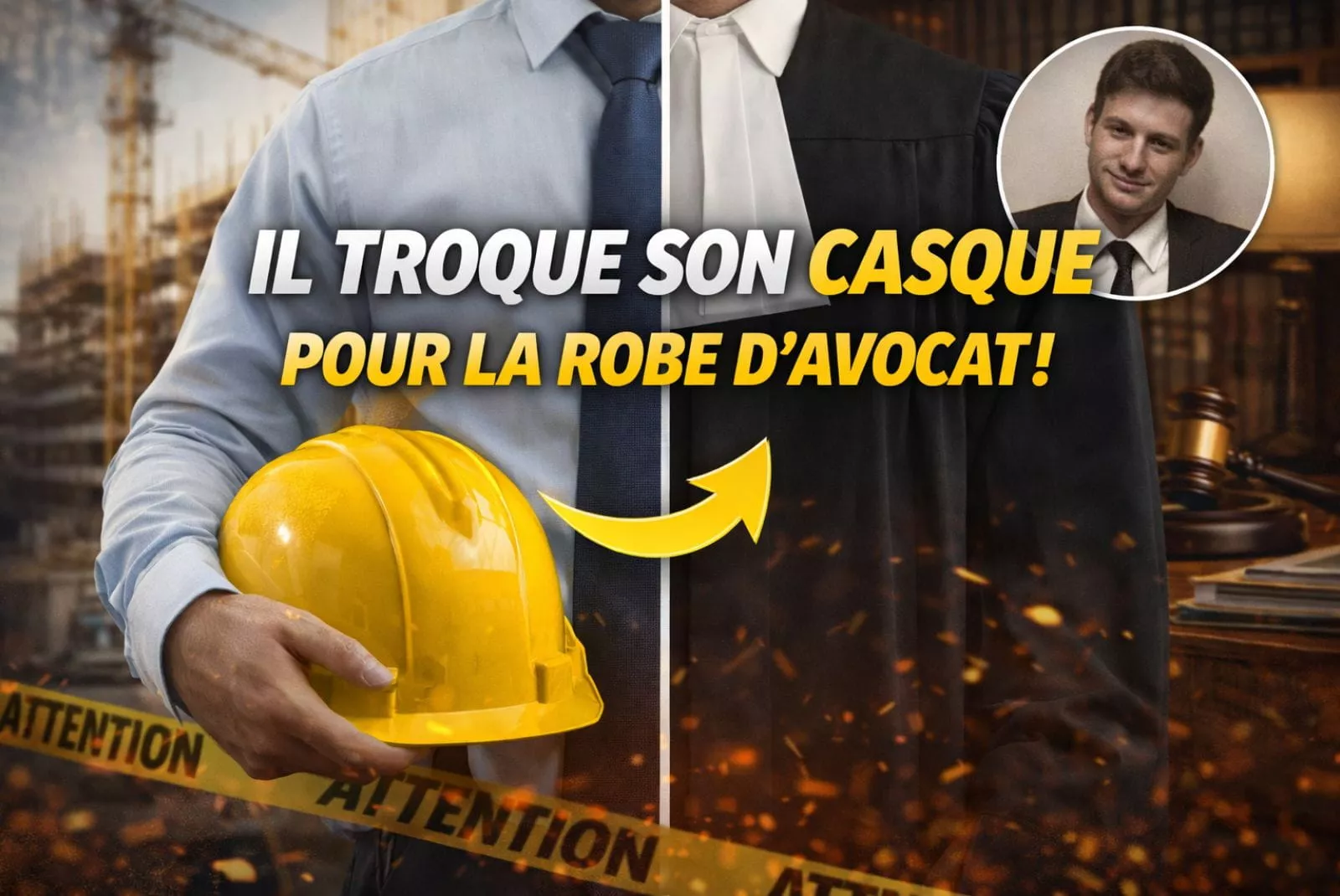
















Anonyme
il y a 2 moisDes syndicaleux qui ne respectent pas les règles : IMPOSSIBLE!!! XD