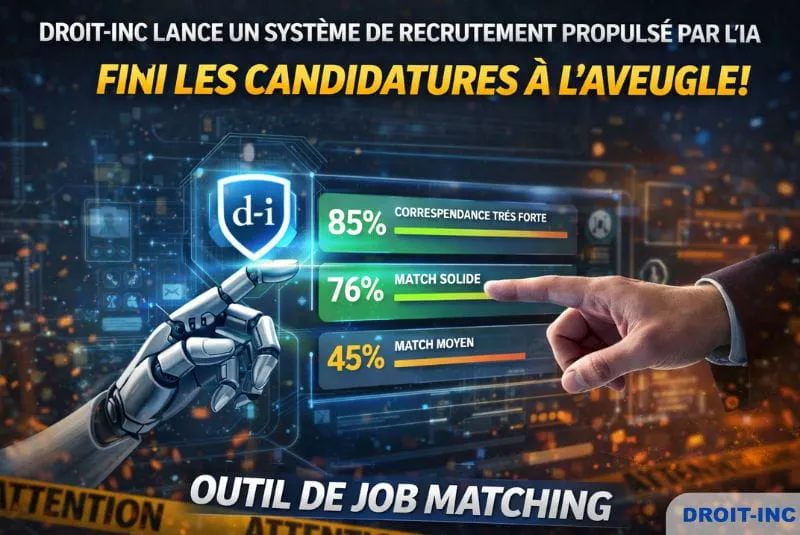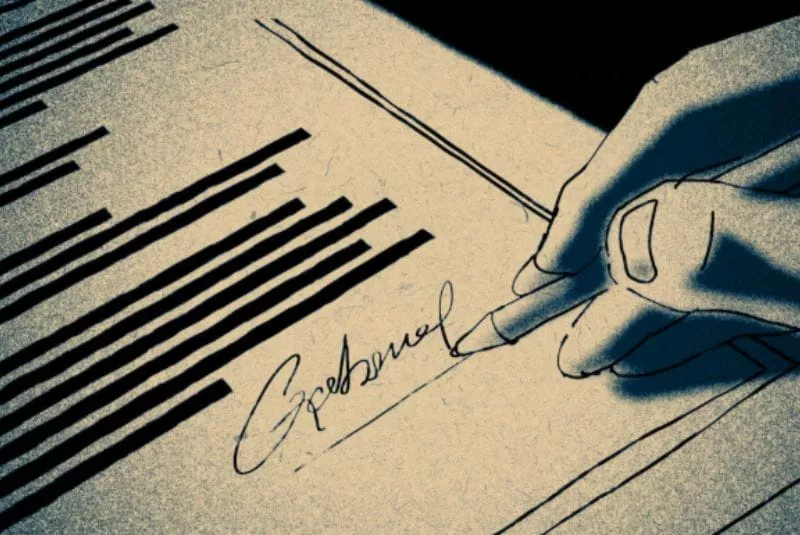Au cœur de la justice de proximité


Ces sept dernières années, Me David Searle a été au plus près du terrain, accompagnant individuellement des milliers de personnes confrontées à des problématiques variées. Au Centre de justice de proximité de Montréal, il a développé une approche de « droit holistique », centrée sur l’ensemble des besoins des usagers.
Il a récemment annoncé sur LinkedIn son départ de l’organisme pour relever de nouveaux défis professionnels. Il y a également souligné sa prise de conscience des limites du système de justice et des populations laissées pour compte, insistant sur l’urgence de repenser l’accès à la justice pour tous.
Qu’entend Me David Searle par « droit holistique »? Quel regard porte-t-il sur sa pratique? Quelles limites du système de justice identifie-t-il? Entretien.
Avec un peu de recul, quels ont été les moments qui vous ont le plus marqué au cours de votre expérience sur le terrain?
La beauté de ce travail, c’est de rencontrer des gens dans leur plus grande vulnérabilité et de pouvoir leur offrir un soutien concret. On développe une relation de confiance, et on reçoit beaucoup de gratitude de nos clients.
Par exemple, je pense à deux femmes âgées et pleines de caractère qui se battaient contre leur propriétaire pour des problèmes dans leur immeuble. Au-delà du litige en lui-même, il y avait surtout un besoin d’être entendues et prises au sérieux. Pouvoir les accompagner dans leur démarche créait un véritable rapprochement et un sentiment de reconnaissance mutuelle. Même si les problèmes n’étaient pas toujours résolus immédiatement, nos rencontres apportaient un soutien réel.
Vous évoquiez une pratique du droit holistique. Pouvez-vous expliquer concrètement ce que cela signifiait et comment vous l’appliquiez au quotidien?
Pour illustrer, j’aime utiliser l’image de l’iceberg que m’a transmise Miville Tremblay, formateur en médiation: le litige en soi n’est que la pointe de l’iceberg. Ce que l’on voit représente seulement une fraction des problématiques sous-jacentes.
En pratique, cela signifie qu’au-delà du litige juridique, je m’intéresse aux besoins émotionnels, financiers et personnels des personnes que j’accompagne. Par exemple, avant même de se lancer dans une procédure judiciaire, il est essentiel que leurs besoins immédiats soient identifiés et pris en compte. Sans cela, elles ne pourraient pas supporter le fardeau d’un processus judiciaire.
Dans la majorité des rencontres, cela implique souvent d’orienter la personne vers des ressources non judiciaires, que ce soit du soutien psychosocial, de l’aide financière ou d’autres services adaptés. L’objectif est de répondre à la personne dans sa globalité, pas seulement à sa problématique juridique.
Votre travail vous a sûrement amené à constater certaines failles du système de justice. Quelles sont celles qui vous semblent les plus préoccupantes et qui vous ont le plus interpellé?
On observe que le système de justice est souvent conçu de haut vers le bas, un peu comme le système de santé, pour reprendre l’image de la chroniqueuse Josée Boileau. Les changements législatifs sont nombreux et le ministère de la Justice est très proactif, mais il reste essentiel de se demander si ces modifications répondent vraiment aux besoins des justiciables.
À mon sens, il faudrait davantage penser la justice du point de vue des personnes qui y ont recours, surtout dans des domaines très humains comme le droit de la famille. Par exemple, la moitié des personnes se représentent seules, alors que le système est pensé pour ceux représentés par un avocat. Il y a donc un décalage entre la conception du système et la réalité des besoins des individus.
Pour terminer sur une note plus personnelle, quelles compétences pensez-vous avoir développées au fil de vos années au centre de justice de proximité, et comment cela vous a-t-il renforcé en tant qu’avocat?
Travailler dans les centres de justice de proximité m’a permis de toucher à plusieurs domaines juridiques, ce qui a considérablement développé mes capacités de recherche et d’analyse juridique. Avec le temps, on se spécialise souvent dans le domaine le plus fréquent ; pour moi, c’était le droit du logement, mais j’ai également développé un intérêt particulier pour les problématiques de harcèlement, au point d’avoir contribué à la création d’une brochure sur le sujet, qui reste une question contemporaine complexe.
Au-delà de l’expertise juridique, ce qui m’a le plus marqué, c’est la dimension humaine du travail. Rencontrer des personnes dans des moments de vulnérabilité m’a permis de renforcer mes compétences en communication et en écoute, et de comprendre l’importance de bâtir une relation de confiance.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook