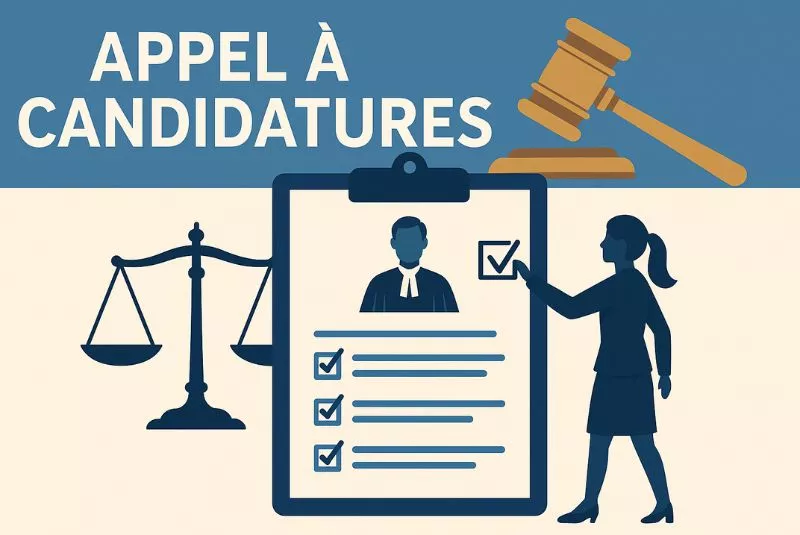Séance ciné : tous derrière Monsieur Lazhar ?

Céline Gobert
2012-02-24 17:00:00
F comme Fuite
Pour qui ?
Les avocats intéressés par le système juridique iranien
Les avocates curieuses d’en savoir plus sur le statut de la femme en Iran

Il y a du féminisme, du drame, du thriller, de la tragédie- humaine, sensible, cinématographique, politique. Il y a de l’intensité, à chaque plan- et un déroulement d’une finesse inouïe qui allie regards, critiques, et instantanés sur la société iranienne, qui explose les préjugés (non, la femme n’y est pas soumise !).
Il part d’une histoire banale (un divorce, une aide soignante embauchée pour s’occuper du père malade) pour dérouler une intrigue d’une complexité redoutable et saisissante, entre engrenage judiciaire, combats d’orgueils et problématiques délicates.
Personne n’a raison (ni tort) dans "Une séparation", mais tout le monde a ses propres raisons d’agir comme il le fait. Souvent, en plaçant- dans la balance- plus important que soi. Sa fille, que l’on veut sauver d’un avenir bouché. Son père, dont on veut préserver la dignité. Son honneur. Son époux. Sa femme. Ses parents. Ce n’est pas un conflit entre le bien et le mal que nous propose le film, mais un conflit d’êtres, dans tout ce qu’ils ont de pire, et de meilleur.
Une première lecture offre un beau drame humain, anxiogène, inattendu. Une seconde dévoile une profondeur sublime, désespérée, résignée mais optimiste : lutte des classes, place de la femme, poids des croyances sur la vie quotidienne.
Farhadi, à un fond d’une richesse étonnante, ajoute une mise en scène calculée, nerveuse quand il le faut, contemplatrice lorsque vient le moment de se taire. De là, le cinéaste iranien, dépasse le cadre de l’intime (le divorce) pour une portée plus universelle.
Au final, "Une séparation" déploie plusieurs séparations à conjuguer : entre un homme et une femme, riches et pauvres, traditions religieuses et modernité, résignation et promesses d’un ailleurs, orgueil et raison. Celle, aussi, d’une jeune adolescente avec le couple parental ; la plus difficile peut-être à accepter, à dire, à assumer. Celle qui clôt le film, magnifiquement. Dans la clarté des évidences.
Face à lui, se tient, la tête haute, Monsieur Lazhar.
Pour qui ?
Les avocats et avocates qui auraient loupé l’un des temps forts de l’année cinématographique québécoise
F comme Fellag
Mais, qui est-il ? D’abord, le héros d’une belle et poignante histoire, basée à Montréal, moins un film sur le deuil que sur l’importance de la communication dans l’art d’enseigner.

Le geste, amené avec autant de délicatesse que de violence lors d’une intro saisissante, a plusieurs répercussions et pose, avec intelligence, différentes problématiques sur la table: comment un enfant appréhende-t-il le deuil ? Que signifie ce suicide au sein d’un milieu éducatif québécois rigide ? Mieux : il amène en filigrane une réflexion sur l’immigration au Québec, la difficulté de s’intégrer, les fossés culturels, le racisme latent de certains.
Philippe Falardeau, après "Congorama" et "La moitié gauche du frigo", met en place une mécanisme fluide, parfaitement huilée, aux accents tragico-tendres véritablement subtils. Il aborde la mort sous divers points de vue, sans jamais sombrer dans le glauque ou le trop plein de noirceur.
On pénètre le monde plein d’émotivité des enfants, celui, glacé et glacial, des adultes, et enfin, celui du mystérieux Monsieur-titre, qui cache derrière une jovialité apparente des plaies de souffrance encore béantes.
Pourtant tiré d’une pièce de théâtre d’Evelyne de la Chenelière, le film respire le cinéma. Et la vie, aussi. Avec un sujet aussi sombre, il en va du petit miracle.
En quelques flashs, d’une beauté foudroyante parce qu’authentique, Falardeau serre le cœur, et tape du poing sur la table. En mariant à la perfection forme et fond, il rappelle que, ni le 7ème art, ni les enseignants, ni personne, ne peut théoriser l’émotion.