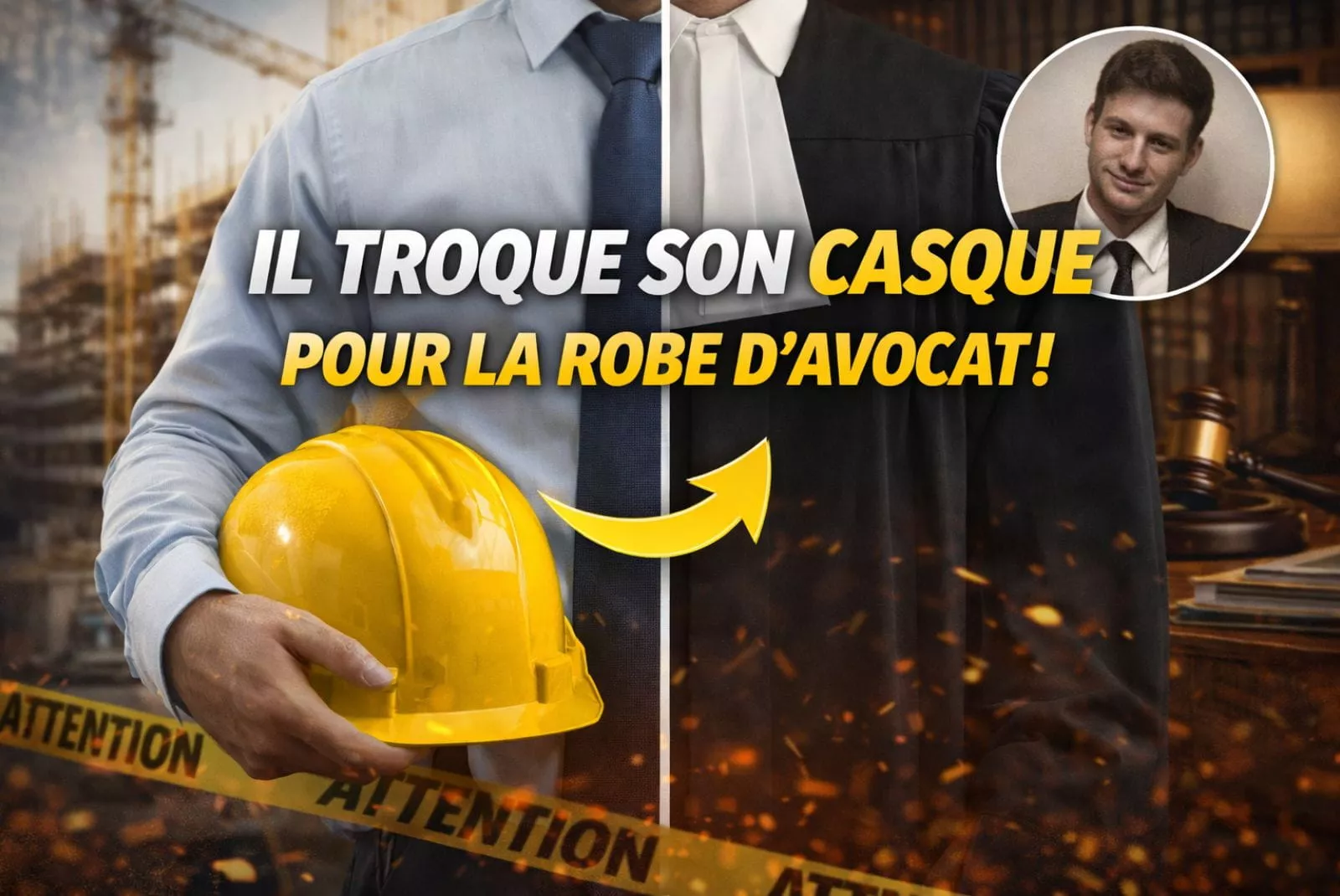Réaffectation d’une policière enceinte: la Ville de Québec déboutée en appel


La Cour d’appel rejette le recours de la Ville de Québec contre un jugement de la Cour supérieure, qui a cassé une décision du Tribunal administratif du travail dans le dossier d’une policière enceinte que la Ville avait refusé de réaffecter à un autre poste.
La décision a été rendue le 27 juin par les juges de la Cour d’appel Julie Dutil, Christine Baudoin et Éric Hardy.
L’appelante, la Ville de Québec, était représentée par Me Louis Ste-Marie et Me Anthony Boilard, avocats chez Cain Lamarre,
L’intimée, la policière Johanie Ouellet, a pu compter sur les services de Me Carolane Lemay et de Me Éric Lemay, de Dussault De Blois Lemay Beauchesne.
Le contexte
Quelques mots sur le contexte, d’abord. Sergente de patrouille pour le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Johanie Ouellet informe la Ville de sa grossesse le 23 décembre 2020. Aucune offre de réaffectation de poste n’est alors faite à la policière, qui est retirée du travail le jour même.
Le 8 janvier 2021, Mme Ouellet demande d’être réaffectée à d'autres tâches durant sa grossesse, estimant que son poste de gestionnaire rend facile sa réaffectation et insistant sur le fait que les femmes enceintes ont la capacité de travailler.
La Ville refusant de la réaffecter, Johanie Ouellet dépose, le 10 février 2021, une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Cet article stipule qu’« un employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi ».
Mme Ouellet estime plus particulièrement avoir fait l’objet de représailles ou de mesures discriminatoires le 13 janvier 2021, à la suite de l’exercice d’un droit prévu à l’article 40 de la LSST, qui garantit à la travailleuse enceinte le droit d’être protégée contre les risques reliés à son travail en lui permettant d’être réaffectée à des tâches moins dangereuses quand c’est possible.
Sa plainte est déclarée irrecevable le 29 avril 2022 par la CNESST et le Tribunal administratif du travail (TAT) confirme cette décision le 16 décembre 2022.
La décision du TAT
Dans sa décision, le TAT fait valoir que la mesure mise en place par le législateur pour la travailleuse enceinte ou qui allaite a pour objet le retrait immédiat du travail. Un employeur, souligne-t-il, n’a pas l’obligation de donner suite à une demande de réaffectation ni d’obligation de réaffecter. Cette décision relève de son droit de gérance, estime le TAT.
À propos de la différence notable entre le salaire de Mme Ouellet et l’indemnisation en vertu de la LSST, le TAT souligne dans sa décision que cette mesure découle d’un compromis sociétal, le propre des « régimes publics d’indemnisation universelle » étant de « générer des iniquités, lorsqu’individualisées à un prestataire spécifique ». Faire droit au recours de Mme Ouellet serait d’ailleurs inéquitable pour les travailleuses à l’emploi de petites organisations qui n’ont pas la possibilité d’être réaffectées, juge le TAT.
Mme Ouellet n’ayant pas établi avoir été l’objet de sanction, de mesures discriminatoires ou de représailles à la suite de l’exercice d’un droit prévu dans la LSST, le TAT déclare sa plainte irrecevable.
Le jugement de la Cour supérieure
Pour la Cour supérieure, la décision du TAT est déraisonnable et ne respecte pas les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Dionne c. Commission scolaire des Patriotes qui reconnaît dans les articles 40 et 41 de la LSST un droit à la réaffectation, bien que celui-ci n’entraîne pas d’obligation de résultat pour l’employeur.
Le TAT a adopté une interprétation trop restrictive et son analyse est tronquée, estime la juge Nancy Bonsaint, qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire et retourne le dossier au TAT pour qu’il rende une décision conforme à la LSST.
Le pourvoi de la Ville de Québec à la Cour d’appel
Pour les procureurs de la Ville, la principale question en litige est de déterminer si la juge a erré en concluant au caractère déraisonnable de la décision du TAT.
Selon eux, la Cour supérieure a erré dans son interprétation de l’arrêt Dionne. Ils estiment que la juge n’a pas appliqué correctement la norme de la décision raisonnable et qu’elle a substitué son opinion à celle du TAT.
Les avocats de la Ville soutiennent également que la juge se méprend sur la portée du mécanisme de retrait préventif de la femme enceinte et que l’interprétation qu’elle en fait n’est pas conforme:
- au texte de la LSST et à ses effets;
- au programme Pour une maternité sans danger établi et appliqué par la CNESST;
- à la jurisprudence.
Ils font également valoir que la juge a erré en décidant que le mécanisme de contestation prévu à l’article 227 de la LSST s’appliquait.
Le jugement de la Cour d’appel
Pour les juges de la Cour d’appel Julie Dutil, Christine Baudoin et Éric Hardy, la juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur révisable et a eu raison de conclure que la décision du TAT est déraisonnable.
« En effet, cette décision occulte les conséquences du retrait systématique du travail pour les travailleuses enceintes qui souhaiteraient y demeurer durant leur grossesse alors que c’est l’élimination à la source des dangers qui devrait primer », écrit la Cour d’appel dans sa décision.
Un employeur, poursuit-elle, n’a pas une obligation de résultat en matière de réaffectation d’une travailleuse enceinte ou qui allaite, « mais il doit agir et prendre les moyens raisonnables pour satisfaire à son obligation de moyen ».
« Pour ce faire, il doit véritablement considérer la demande de réaffectation et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que la travailleuse sera retirée du travail et recevra une IRR [indemnité de remplacement de revenu]. Il a aussi l’obligation, le cas échéant, de faire part à la travailleuse des raisons qui font en sorte qu’elle ne peut être affectée à d’autres tâches durant sa grossesse », tranche la Cour d’appel.
Le TAT devra donc se prononcer sur le fond et déterminer si Mme Ouellet a subi ou non une sanction au sens de l’article 227 de la LSST, et ce, à la lumière des motifs invoqués par la Ville pour refuser la réaffectation.
Au moment de mettre cet article en ligne, aucun des avocats impliqués dans Ville de Québec c. Ouellet n’avait donné suite à notre demande de commentaires.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook