L’avocate engagée… de mère en fille

Céline Gobert
2018-08-22 15:00:00

Ancienne procureure au Service des poursuites pénales du Canada et ex-candidate du NPD fédéral, la juriste de 41 ans vient d’être désigner par le Canadian Lawyer Magazine parmi les avocats d’influence en 2018, dans la catégorie Gouvernement/organisations sans but lucratif/associations.
La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre: elle est la fille de Louise Arbour, que Droit-inc a rencontré récemment alors qu’elle venait d’être nommée représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour les migrations internationales. Émilie Taman baigne depuis longtemps dans un environnement sensible aux inégalités et aux personnes vulnérables.
Barreau de l’Ontario 2006, elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Dalhousie, située à Halifax ainsi qu’un diplôme en sciences politiques à McGill (2000).
Alors qu’elle termine un mandat de deux ans comme enseignante à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa Me Taman est revenue avec Droit-inc sur sa carrière.
Droit-inc : Commençons avec votre podcast sur le droit pénal que vous animez depuis 2015. Comment tout ça a commencé?
Me Emilie Taman : Le podcast s’appelle «The Docket», un mot qui désigne la liste de causes devant être entendues en Cour dans une journée. Mon conjoint Michael Spratt, qui est avocat de la défense en droit pénal, l’avait commencé avec un collègue, puis je l’ai rejoint. Notre but est de rendre plus accessible des controverses ou des questions de droit pénal au public, souvent mal informé.
Ça a commencé parce qu’on aurait aimé écouter un podcast sur l’émission Making a Murderer sur Netflix et qu’on en trouvait pas. Alors on l’a fait nous-même et on a consacré un épisode de podcast à analyser chaque épisode. Par la suite, ma mère juge à la Cour suprême (ndlr : Louise Arbour) nous a rejoint, et le podcast a explosé!
Quels sont les enjeux récents et les problématiques en matière de droit pénal qui vous interpellent?
Là en ce moment on parle d’une autre émission Netflix, The Staircase (ndlr : la série relate l'histoire du procès controversé du romancier Michael Peterson). Sinon, je dirais l’affaire de l’autochtone Colten Boushie tué en Saskatchewan par un fermier, Gerald Stanley. L’accusé a été acquitté par le juge. Dans le podcast, on explique comment on sélectionne les jurys au Canada, et comment on gère les questions de «races» dans un procès criminel. On explique le contexte légal puis on s’engage dans une discussion.
On parle aussi beaucoup de la question des délais dans le système pénal et de l’arrêt Jordan avec des arrêts de procédures dans des procès pour meurtres parce que ça a duré trop longtemps.
Il y a aussi toutes les questions autour des réfugiés et des femmes qui vous préoccupent beaucoup…
Pour les réfugiés, j’ai choisi de m’impliquer dans un parrainage privé de réfugiés syriens à Ottawa. Bientôt je vais parrainer une troisième famille, avec un groupe de voisins de ma communauté. Quand j’étais procureure au Service des poursuites pénales du Canada, j’ai vu beaucoup de fraudes en immigration, j’ai vu comment le système pouvait être vulnérable. Notamment sur ce programme privé de parrainage de réfugiés.
Donc c’était vraiment une volonté personnelle?
Oui. J’ai aussi été bénévole au sein du Programme d’appui au parrainage de réfugiés. Les avocats peuvent aider les gens avec leurs documents, ou encore les informer sur le montant d’argent qu’il faut en banque pour que ça soit approuvé.
Ça rejoint les femmes aussi, car ce sont souvent elles qui se retrouvent les plus vulnérables. Elles ont peur d’appeler la police dans des situations de violence dans leur mariage par exemple, de peur de perdre leur statut.
Pourquoi la cause des réfugiés vous tient-elle tant à coeur?
En 2015, on a commencé à voir un mouvement de société dans lequel les gens s’impliquaient davantage à aider ces personnes parmi les plus vulnérables au monde. Maintenant, on voit aux nouvelles ce qui leur arrive, c’est accessible à tous et c’est choquant. Souvent on se demande ce qu’on peut faire de concret, comment s’engager pour avoir un impact.
Avec ma mère, Haut-Commissaire aux droits de l’homme et procureure générale du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, j’ai vu à quel point il y avait des gens vulnérables. Ici, on est un pays riche, avec beaucoup de ressources. Alors si l’on peut faire quelque chose…
Justement, j’allais vous demander ce que ça faisait d’avoir une mère comme Louise Arbour…

Par esprit de rébellion!
Oui! C’était une sorte de rébellion académique! (Rires) Mais à McGill, je lisais beaucoup les journaux, et je me suis de plus engagée sur des questions politiques ou de droit. Finalement…(Rires)
Vous venez d’ailleurs d’être désignée par le Canadian Lawyer Magazine comme l’une des avocates les plus influentes en 2018. Vous considérez-vous vous-même comme une «influenceuse», un modèle pour les jeunes?
Être nommée parmi des poids lourds comme le procureur général de l’Ontario ou le juge en chef du Canada, c’était incroyable! (Rires) Après, je ne me pense pas comme quelqu’un qui a de l’influence mais quand j’ai la chance disons «éduquer» sur certaines questions de droit, je le fais.
Je le vois dans mon travail d’enseignante à l’Université d’Ottawa, c’est une énorme responsabilité, surtout auprès d’élèves qui entrent en première année, les futurs avocats. Il faut leur parler de leur rôle comme avocats de la défense, ils sont des «défenseurs» du droit. Je pense aussi qu’il est important de rappeler le contexte dans certains débats publics.
Par exemple?
Sur la question de la décriminalisation des drogues, et le débat entourant la légalisation de la marijuana. Beaucoup de jeunes pensent qu’avec la légalisation qui s’en vient, il n’y a pas de poursuites pour possession de marijuana, mais c’est faux il y en a plein!
D’ailleurs, vous prenez position sur la légalisation de toutes les drogues.
Je pense qu’au moins la décriminalisation est importante. Il y a tellement de barrières pour ceux qui souffrent de la toxicomanie ou qui ont des problèmes de criminalité liés à la dépendance aux drogues...Si l’on regarde le tort que fait la consommation de cannabis contre le tort du système pénal, le deuxième est pire que la drogue elle-même. Ça n’aide pas les gens de les mettre en prison. Il faudrait plutôt accorder plus de ressources pour le traitement et la santé mentale en général.
Vous avez participé à l'élection fédérale de 2015 et à une élection partielle en 2017, comme candidate du NPD fédéral. Pourquoi vous être tournée vers la politique?
Quand j’étais procureure, c’était les années Harper. J’éprouvais des difficultés avec la direction que prenaient nos politiques en droit pénal. Harper prônait des peines plus longues, créait de plus en plus d’infractions, lançait la très critiquée Loi antiterroriste C-51. Je ne pouvais plus continuer à faire mon travail dans un contexte qui allait à l’encontre de mes valeurs. J’en avais marre de me plaindre, je voulais faire quelque chose de concret.
Est-ce que vous êtes plus satisfaite des politiques de Trudeau?
(Rires) Honnêtement, surtout dans mon domaine, je suis très très déçue. Le gouvernement avait promis de réinjecter plus d’égalité dans le système, de renverser la politique d’Harper, ou de régler des questions comme celles des peines minimum ou de la réforme électorale, mais il n’y a pas touché.
Quels sont vos projets maintenant? Comptez-vous vous représenter aux élections d’octobre 2019?
C’est une option que je considère mais je n’ai aucune idée de où va aller ma carrière. Je viens de finir mon contrat d’enseignement à Ottawa. Je voulais me lancer au niveau municipal mais finalement, pour des raisons personnelles, j’en ai conclu que ce n’était pas le bon moment.
Partager cet article:

 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook









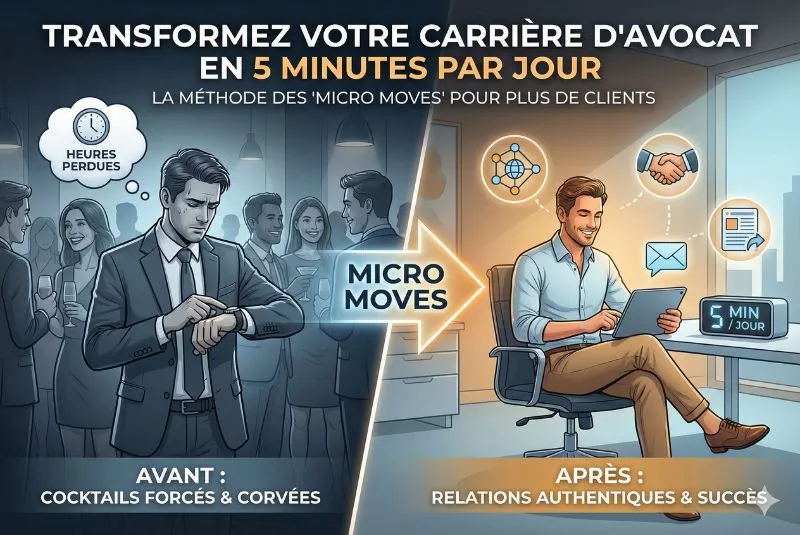





Anonyme
il y a 7 ansLa majorité des Syriens ayant seulement fuis la guerre sont retournés (ou retournent) chez eux, maintenant que les russes ont fait le ménage en Syrie, et ceux qui continuent de vouloir rester ici en revendiquant un statut de réfugié sont très majoritairement des escrocs du "droit humanitaire".
Anonyme
il y a 7 ansah bon, c'est tout réglé définitivement? Ceux qui ont vécus dans des camps, peuvent retourner dans leurs maisons? Reconstruites? Plus aucun problème? Avec abondance de nourriture, hopitaux et écoles? Et des possibilités de faire de l'argent pour ne pas crever de faim?
Des escrocs? Rien de moins?
Anonyme
il y a 7 ans"réglé définitivement", une belle formule magique du droit humanitaire pour justifier qu'un réfugié s'incruste !
Le conflit est suffisamment réglé pour qu'on puisse y vivre, mais peut-être pas définitivement puisque l'occident cherche encore à y semer le chaos.
Les haitiens accueillis par les USA après le dernier tremblement de terre, et qui y étaient encore jusqu'à ce que Trump mette fin au décret d'accueil, je suppose que vous vous opposez à leur expulsion au motif que le problème des tremblements de terres en haiti ne sont pas réglés définitivement?
Anonyme
il y a 7 ansBelle tentative de changer de sujet: on parle de la Syrie.
Vus savez le pays où il y a moins de 4 mois il y aurait eu des attaques au gaz et où ce mois-ci il y avait des bombardements et où vos idoles les russes bombardent encore régulièrement depuis leurs avions. Au final, il y a encore des milliIONS de personnes déplacées.
Mais, eh, oublions le tout, il faut qu'ils quittent, il n'y a plus de problème, ils sont des profiteurs selon l'expert de salon que vous êtes.
Anonyme
il y a 7 ans"Thousands who fled recent fighting in Syria return home" titre le Globe & Mail.*
Ceux qui provienent des zones reprises en main par l'état Syrien peuvent retourner chez eux, et lorsque la dernière province encore contrôlée par l'EI (au nord) sera tombée, tous pourront le faire.
* http://www.theglobeandmail.com/world/article-thousands-who-fled-recent-fighting-in-syria-return-home-2/
Anonyme
il y a 7 ansEst-ce que t'as juste lu la manchette ou est-ce que tu ne comprends pas ce que tu lis? Le retour, d'après TON texte, ce sont des gens qui ont fui des bombardements aériens dans les dernières semaines. Si l'extrait suivant te laisse croire qu'un retour est possible, soit tu ne comprends pas, soit tes préjugés t'empêchent de comprendre quoi que ce soit.
Many families who sought protection from bombardments and shifting front lines continue to live out in the open, CARE said. They “are in desperate need of food, shelter and clean water, which is scarce and prohibitively expensive due to the high demand in densely populated areas,” it added.
Pedersen said the UN organizations need to respond to the populations in southwest Syria, especially the displaced returning home from the Jordanian border and from near the Golan Heights, where they have fled airstrikes and shelling in the past weeks.
Anonyme
il y a 7 ans"Si l'extrait suivant te laisse croire qu'un retour est possible,..."
Faites le tour des articles couvrant l'ensensemble du territoire Syrien*, et vous aurez confirmation que la dernière zone problématique est au nord, et pas très vaste.
Anonyme
il y a 7 ansCe n'est effectivement pas une revue de presse. Vous pouvez donc cesser de poster des liens vers divers articles de journaux. Merci.
Anonyme
il y a 7 anshahaha, le gars se fait boucher par l'article qu'il avait présenté comme supportant son point de vue.
Maintenant il dit "ce n'est pas une revue de presse, allez voir ailleurs, l'article que j'ai posté n'est pas bon".
Si le ridicule tuait, tu serais en grave danger hahaha
Pierre
il y a 7 ansAttendez.
On savait que Louise Arbour avait fait un tort considérable au Canada et à l’occident avec sa politique de frontière ouverte et maintenant on Apprend que sa fille continue son travail?
Deux gravols s’il vous plaît.
Anonyme
il y a 7 ansLouise n'a pas encore accroché ses patins, comme en témoigne cet article récent du Monde sur les migrations:
Louise Arbour : « Une migration bien gérée est à l’avantage de tout le monde »
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/02/louise-arbour-une-migration-bien-geree-est-a-l-avantage-de-tout-le-monde_5264729_3210.html?xtmc=louise_arbour&xtcr=2
(les commentaires de lecteurs valent la peine...)
Anonyme
il y a 7 ansQuoique je ne doute pas de son talent juridique, il me semble que ça fait des décennies que Louise Arbour court après les caméras dans le but de démontrer qu'elle a une conscience sociale nettement supérieur à la moyenne. Les média embarquent dans ce jeu à 100%. II semble que sa fille a la même pénurie de modestie.
DSG
il y a 7 ansThese do-gooders put themselves on pedestals for helping a family of refugees and then tell us what we're doing wrong. Allow me to downstairs and give a homeless a sachet of Cup-a-Soup and I'll come back here to tell you how greedy and heartless the rest of you are.
Anonyme
il y a 7 ansBon, bon, bon, garde la gang qui n'a accompli que très peu qui s'en prennent à ceux qui ont réussis. Par jalousie et mesquinerie. Lâchez-pas!
Anonyme
il y a 7 ansJe pense que j'ai accompli pas mal de choses ( vous ne me connaissez pas). Je ne tiens pas tout simplement à faire valider mes réussites par les media.