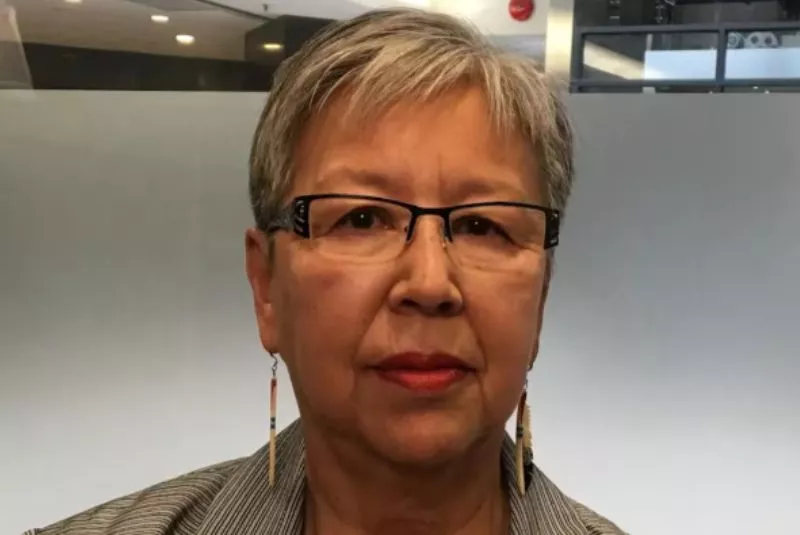Des questions pour la Commission

Louis Lapointe
2012-10-25 10:15:00
Si tel était le cas, il a bien dû y avoir des fonctionnaires honnêtes qui ont porté plainte à la police, au SPVM ou à la SQ.
Comment se fait-il que ces corps policiers n’aient rien fait avant 2009, année durant laquelle tous les médias de Montréal ont sorti leurs petits scandales sur le sujet, alors que ce système existait déjà depuis le début des années 2000 ?
Pourquoi a-t-il fallu attendre la création de l’escouade Marteau et de l’UPAC en 2009 pour que la police et la direction des affaires criminelles s’en mêlent ?
Les hauts dirigeants de nos corps de police ont-ils toute l’indépendance nécessaire pour agir dans ce genre de situation ou sont-ils l’objet du même système qu’à la Ville de Montréal ?
Les policiers du Québec ont-ils les compétences et l’éthique requises pour affronter ce genre de problème ?
Des questions légitimes à poser compte tenu du peu d’empressement de nos policiers à agir dans ce dossier.
Il ne faut surtout pas oublier que ce sont nos élus, les maires et le premier ministre, qui nomment les chefs de police, à Montréal, à Laval et à la SQ.

« Je suis également de ceux qui comprennent pourquoi Serge Ménard n’a pas dénoncé Gilles Vaillancourt. Il a eu peur. Il a eu peur qu’on ne le croie pas. Il a eu peur de voir sa carrière brisée. Un sentiment que je connais bien.
En raison de son expérience d’avocat - il a représenté de nombreux policiers - il se doutait probablement qu’il existait au Québec une catégorie de personnes très puissante qu’on ne pouvait pas dénoncer parce que la police ne ferait rien, pas parce qu’elle ne voulait pas, mais bien parce qu’elle ne pouvait pas. Il a pu penser que des gens très hauts placés au Québec préféraient ne pas savoir ce genre de choses. Impression que son passage à la Sécurité publique ne semble pas avoir atténuée.
On se demande bien pourquoi des ministres - avocats par surcroît - titulaires de la Justice et de la Sécurité publique ont mis si peu de zèle à dénoncer des situations qu’ils savaient irrégulières, 7 ans dans un cas, 17 ans dans l’autre. Doutaient-ils de leur capacité à convaincre leur propre police ou refusaient-ils tout simplement de mettre leur gouvernement dans l’eau chaude parce que leurs carrières étaient en jeu ? »
Tout ceci expliquerait-il cela ?
Des questions légitimes pour la Commission Charbonneau.
Note
Ce billet de Louis Lapointe a initialement été publié sur Vigile.net hier. Il est reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur.
Partager cet article:

 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook