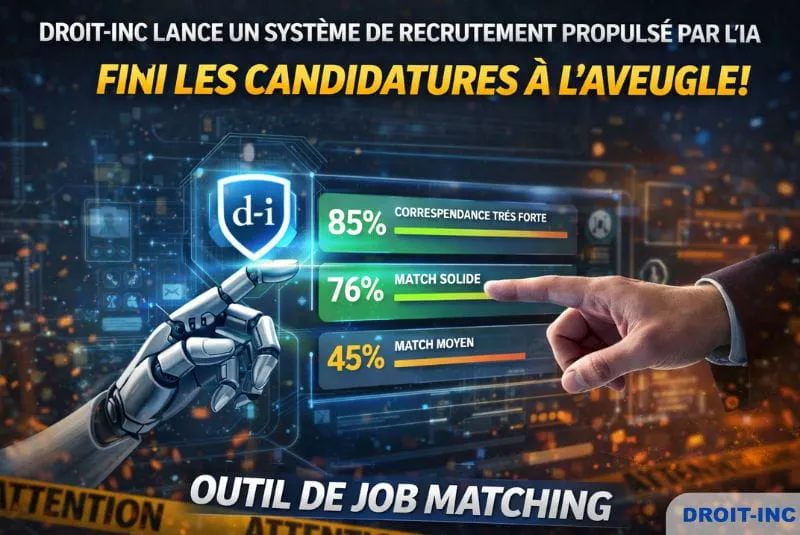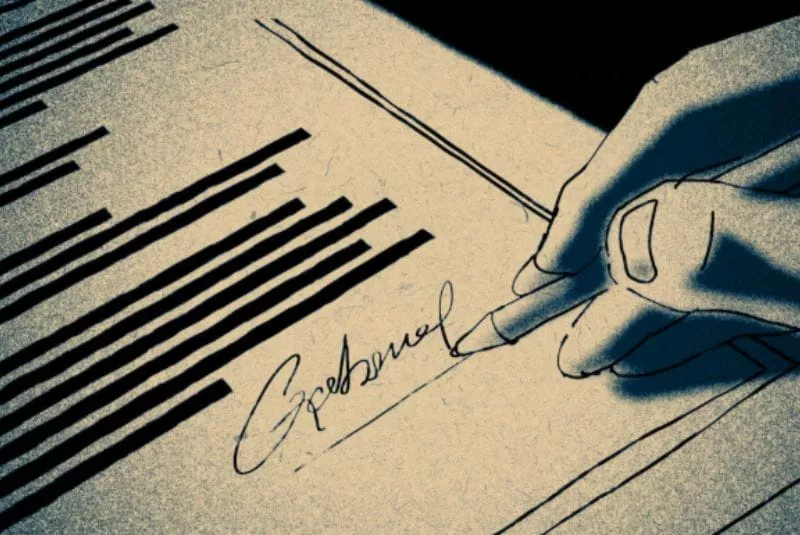L'avocate engagée pour soutenir les victimes de violences conjugales


Dès l’enfance, Me Marilyn Coupienne rêvait de devenir avocate. « Au primaire, nous avions monté une pièce de théâtre inspirée d’une cause en droit familial, ce qui nous avait menés jusqu’au palais de justice », raconte-t-elle.
À seulement 12 ans, elle est immédiatement fascinée par l’ambiance du palais de justice, la salle d’audience et, surtout, par le rôle de l’avocate. « À partir de ce moment, je n’ai plus jamais remis ce choix en question ».
Pas étonnant donc, de la voir aujourd’hui occuper le rôle de conseillère juridique et formatrice sociojudiciaire au sein de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. C’est ici qu’elle accompagne les intervenantes et partenaires pour mieux comprendre les enjeux juridiques et protéger les droits des femmes victimes de violence.
Mais comment est né son intérêt pour la justice sociale? Quel accompagnement propose-t-elle concrètement aux intervenantes de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes? Et quels sont les enjeux juridiques actuels entourant la protection des victimes de violences conjugales? Nous lui avons posé toutes ces questions.
Qu’est-ce qui vous a menée vers le domaine du droit et, plus particulièrement aujourd’hui, vers le travail auprès des femmes en contexte de violence?
Lorsque j’ai entrepris mon baccalauréat, j’ai délibérément choisi l’UQAM en raison de son orientation en droit social. J’ai effectué mon stage à l’aide juridique, où j’ai été choisie en jeunesse, un secteur qui touche autant au criminel pour les jeunes contrevenants qu’à la protection de la jeunesse. Après mon stage, j’ai pratiqué quelque temps en privé, toujours en criminel et en jeunesse.
Cette période a été très difficile. J’ai été bouleversée par le traitement réservé aux personnes accusées et aux familles par certains acteurs du système : juges, procureurs, avocats de la DPJ…
J’avais l’impression que les dynamiques de pouvoir et les façons de faire étaient les mêmes, que ce soit en criminel ou en protection de la jeunesse, malgré les mandats juridiques pourtant très différents. Cette dissonance m’a poussée à entreprendre un doctorat.
C’est vraiment en constituant ma banque de données, à savoir l’analyse de 100 dossiers judiciaires portant sur la négligence à la Chambre de la jeunesse, que j’ai constaté l’existence d’un traitement différencié envers les mères. Ce que les chercheuses féministes dénonçaient depuis longtemps se reflétait précisément dans mes données : une sévérité accrue envers les mères et une rigidité beaucoup plus marquée dans les sanctions appliquées.
Pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de cette thèse?
Elle porte sur la construction sociale de la négligence à la Chambre de la jeunesse de Montréal. Plus précisément, j’analyse la façon dont les acteurs du système de justice, les intervenants de la DPJ et les juges, qui détiennent un pouvoir décisionnel important, définissent et construisent la négligence comme une forme de déviance.
Et ce que mes données montrent, c’est que cette déviance est très souvent présentée comme une déviance maternelle. J’examine non seulement les comportements pouvant être considérés comme négligents, mais aussi tout l’enjeu du rapport à l’institution.
Autrement dit : dès qu’une famille entre dans le système, la manière dont les parents collaborent ou interagissent avec la DPJ influence directement la possibilité qu’ils puissent ou non retrouver la garde de leur enfant. Ma thèse s’inscrit donc clairement dans le champ de la protection de la jeunesse.
C’est dans ce contexte que j’ai été approchée par la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes afin de développer ce que nous appelons le projet sociojudiciaire. L’objectif est d’améliorer la réponse du système de justice aux violences faites aux femmes, pas seulement la violence conjugale, mais toutes les formes de violence vécues par les femmes.
Concrètement, cela consiste à offrir de la formation juridique aux maisons d’hébergement et à sensibiliser nos partenaires socio-judiciaires pour qu’ils comprennent mieux les réalités, les violences et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées. Nous en sommes maintenant à la deuxième année de ce projet, qui s’échelonne sur cinq ans.
Pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre rôle à la Fédération des maisons d’hébergement. Comment accompagnez-vous les intervenantes et quels sont, selon vous, les principaux défis qu’elles rencontrent?
Essentiellement, mon rôle est double : je suis conseillère juridique et formatrice. Je ne représente pas directement les femmes, mais bien les maisons d’hébergement. Mon travail consiste à conseiller les directrices et intervenantes sur des enjeux propres aux maisons : sécurité, confidentialité, mais aussi sur des vides juridiques où il n’existe pas de législation claire ou où de nombreuses exceptions s’appliquent.
Je reçois également beaucoup de demandes pour aider les intervenantes à mieux informer les femmes sur leurs droits et leurs options.
Un constat frappant est que les femmes victimes de violences sont souvent mal représentées, voire pas représentées du tout. Les dossiers en violence conjugale et familiale sont complexes et difficiles à gérer pour les professionnels du droit, qu’ils soient en pratique privée ou à l’aide juridique.
Les femmes elles-mêmes vivent souvent des séquelles de la violence : stress post-traumatique, pertes de mémoire, isolement, ce qui rend leur accompagnement encore plus délicat.
Pour pallier ces difficultés, j’ai conçu avec une collègue, intervenante en maison d’hébergement, une formation complète destinée aux intervenantes. L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre les bases du droit, qu’il soit criminel, relatif à la protection de la jeunesse ou au droit de la famille, afin qu’elles puissent naviguer dans le système et accompagner efficacement les femmes, même si elles ne fournissent pas de conseils juridiques à proprement parler.
J’ai également lancé une étude exploratoire sur la « violence judiciaire ». Nous documentons les expériences vécues par les femmes, les stratégies de contrôle utilisées et leurs conséquences.
Et pour conclure, avez-vous identifié d’autres modèles ou exemples appliqués dans d’autres pays qui pourraient être intéressants à adapter ici au Québec?
Certains pays ont déjà criminalisé le contrôle coercitif. C’est le cas de l’Angleterre, de l’Écosse et de quelques États aux États-Unis. Cette criminalisation ne résout pas entièrement le problème, mais elle permet de considérer la violence conjugale comme un ensemble de comportements de contrôle, et non comme des actes isolés comme l’agression physique ou sexuelle.
Cela offre une définition plus complète de ce qu’est réellement la violence conjugale. Bien sûr, il existe des risques, comme des accusations de contrôle coercitif portées à tort, mais le cadre législatif est beaucoup plus précis.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook