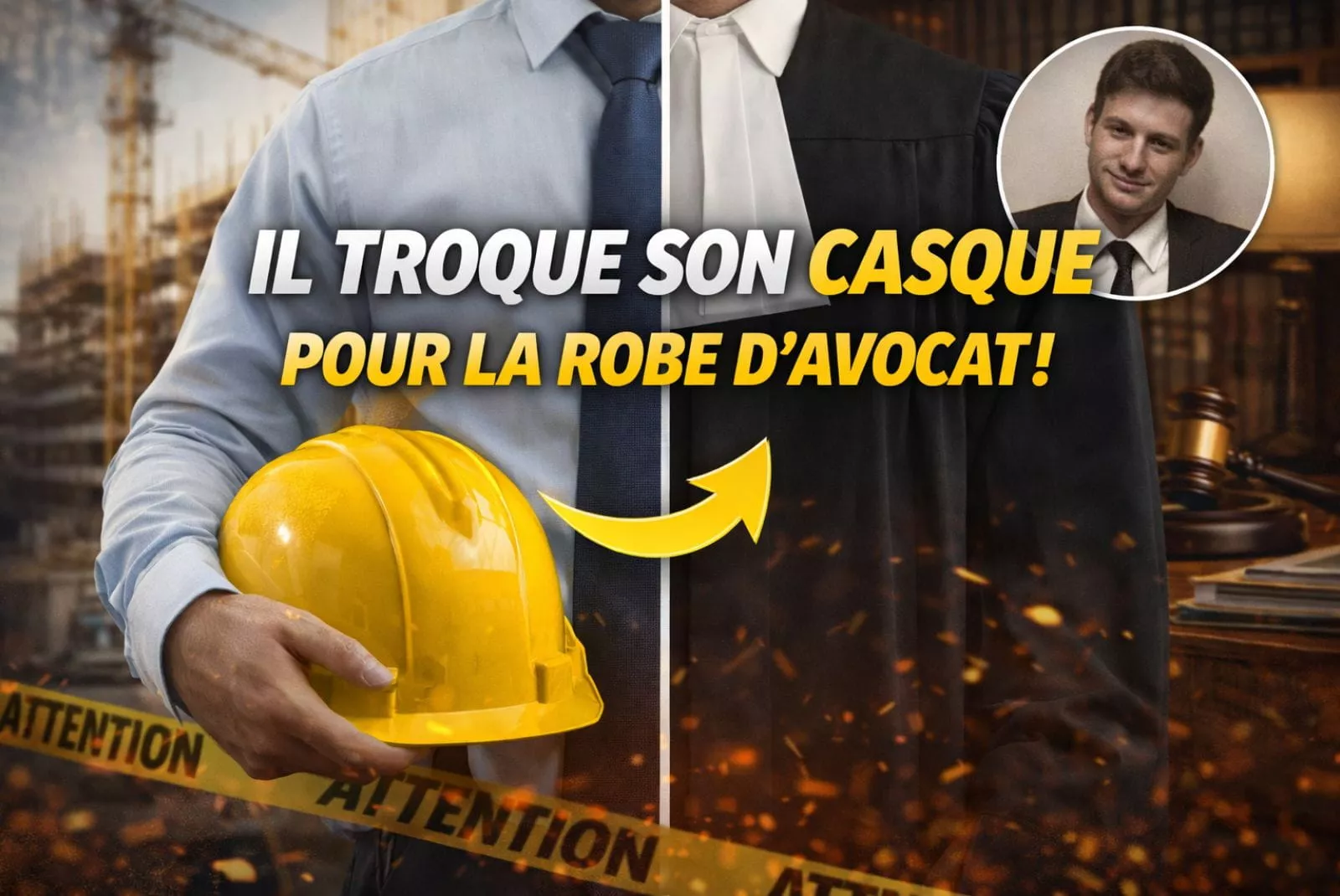59 jours de trop

En plus de refuser d’entendre la DPJ, la Cour suprême l’a condamnée à payer les dépens à l’enfant lésé. Une décision sévère?

La DPJ s’est adressée au plus haut tribunal du pays dans l’espoir de faire renverser la décision de la Cour d’appel du Québec dans un dossier de lésion de droits d’un enfant, sans succès.
La décision de la Cour suprême rejetant la demande de la DPJ a été rendue le 18 septembre.
L’enfant, le mis en cause, était défendu par Mes Mylène Leblanc et Patricia Collin, du cabinet Leblanc avocate.

Le CIUSSS, l’appelant (pour la DPJ), était représenté par Mes Gabriel Destrempe Rochette et Ève Sasseville.
Me Isabelle Gilles, du cabinet Bitzakidis Clément-Major Fournier, agissait pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, intervenante dans ce dossier.

En refusant d’entendre la DPJ, la Cour suprême confirme le jugement rendu le 2 avril dernier par les juges de la Cour d’appel Julie Dutil, Patrick Healy et Michel Beaupré, dont les grandes lignes sont résumées plus loin.
59 jours de délai
L'affaire concerne un enfant et sa mère originaires du Rwanda. Entre le 28 septembre et le 25 novembre 2022, la DPJ a retenu cinq signalements successifs pour des situations présumées d'abus physiques et/ou de mauvais traitements psychologiques impliquant la mère ou la grand-mère.
Les quatre premiers signalements, décrivant notamment des menaces et de la correction physique, ont été classés avec un code 3 (intervention à l'intérieur de quatre jours ouvrables).
Ce n'est qu'au cinquième signalement, le 25 novembre 2022, qui rapportait une marque au visage de l'enfant et mentionnait des coups de bâton, qu'un code 1 (intervention immédiate) a été attribué.

L'intervention, ce jour-là, a mené au retrait immédiat de l'enfant et à son placement en famille d'accueil, confirmant la compromission de sa sécurité et de son développement.
Un délai total de 59 jours s'est donc écoulé entre le premier signalement retenu et la première intervention de la DPJ auprès de l'enfant.
Les décisions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure
L’avocate de l’enfant a déposé une demande en déclaration de lésion de droits.
Dans son jugement rendu le 24 juillet 2023, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a accueilli la demande en protection, déclarant la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Elle a conclu que les droits de l’enfant de recevoir des services adéquats, en temps utile et avec diligence pour assurer sa protection, avaient été lésés.
La DPJ a fait appel de cette décision, sans plus de succès.
Dans sa décision rendue le 12 juillet 2024, la Cour supérieure a confirmé la déclaration de lésion des droits. Elle a aussi jugé que la question des ressources de la DPJ invoquée par le CIUSSS n'était pas pertinente pour l'analyse de la lésion de droits.
Les positions des parties devant la Cour d’appel
La DPJ a de nouveau fait appel de cette décision devant la Cour d’appel. Cet appel ne portait que sur la déclaration de lésion des droits de l'enfant.
La DPJ soulevait deux moyens d'appel principaux :
- La juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en ne considérant pas les ressources humaines, matérielles et financières de la DPJ pour déterminer s'il y avait lésion du droit de recevoir des services sociaux adéquats.
- La juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur de droit en omettant d’identifier le droit en cause et d’apprécier sa conduite selon la norme de la décision raisonnable.
L'enfant et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contestaient les prémisses de la DPJ. Ils soutenaient que le droit lésé était celui à la sécurité et à la protection (art. 39 Charte québécoise), et non uniquement le droit aux services soumis aux ressources.
Ils affirmaient aussi que la prise en compte des ressources n'était pas pertinente et que la norme de la décision raisonnable ne s'appliquait pas à la détermination d'une lésion de droits.
La décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a rejeté l'appel de la DPJ.
Elle a d'abord rectifié le droit en cause et confirmé que la lésion ne portait pas uniquement sur le droit de recevoir des services sociaux adéquats (art. 8 LPJ), mais sur les droits fondamentaux de l'enfant à la sécurité et à la protection, consacrés notamment à l'article 39 de la Charte québécoise.
L'interprétation de l'article 91 al. 4 LPJ, qui permet de déclarer la lésion des droits, doit être large et libérale pour assurer la protection la plus complète de l'intérêt de l'enfant, qui est la considération primordiale, a souligné la Cour d’appel.
Les juges Dutil, Healy et Beaupré ont estimé que l'analyse de la lésion de droits devait être centrée sur l'enfant et son intérêt, et non sur les contraintes budgétaires ou administratives de l'établissement.
Selon le plus haut tribunal du Québec:
- Le délai de 59 jours entre le premier signalement et l'intervention a causé une lésion de ces droits fondamentaux
- Le fait que le manque de ressources puisse être la cause du délai ne peut faire obstacle à la déclaration de lésion de droits.
- L'article 91 al. 4 LPJ vise justement à corriger l'action ou l'inaction de l'État qui ajoute aux préjudices subis par l'enfant.
Les trois juges ont du reste estimé que la norme d'intervention de la Cour d'appel est celle de la décision correcte sur les questions de droit. Selon eux, l’application de la norme de la décision raisonnable « s’inscrit en faux avec le cadre d’analyse applicable en matière de lésion de droits ».
La Cour d'appel a donc confirmé que la déclaration de lésion des droits est une protection supplémentaire exceptionnelle accordée à l'enfant lorsqu'il est victime d'un manquement, et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer même lorsque les ressources de l'organisme public sont limitées.
« De l’acharnement! »
Tout en se réjouissant de la décision de la Cour suprême, les avocates de l’enfant lésé n’ont pas manqué de blâmer la DPJ pour son « acharnement ».
En entrevue avec Droit-inc, elles ont dit ne pas comprendre que malgré le contexte budgétaire québécois, et alors que la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel avaient rejeté les demandes de la DPJ, celle-ci se soit quand même adressée à la Cour suprême.
Mes Leblanc et Collin se sont néanmoins dites « honorées » d’avoir pu représenter cet enfant jusqu’au plus haut tribunal du pays. Aussi souhaitent-elles que la décision de la Cour suprême « aura un impact positif sur la protection de la jeunesse à l’échelle du Québec ».
Les avocates mentionnent au passage que le recours pour faire reconnaître la lésion de droits d’un enfant demeure peu connu et « parfois mal perçu ».
« Certains prétendent qu’il engorge les tribunaux, alors qu’en réalité, seules environ 80 demandes en lésion de droits sont déposées chaque année dans tout le Québec », précise Me Leblanc, tout en rappelant que l’enfant est un humain et un citoyen à part entière, et qu’il possède les mêmes droits qu’un adulte.
Vu la multiplication des procédures et « l’acharnement » de la DPJ, Mes Leblanc et Collin ont demandé à la Cour suprême que les dépens soient assumés par l’appelante et octroyés directement à l’enfant. « C’est ce que la Cour suprême a décidé. Et ça, j’ai jamais vu ça! » s’est réjoui Me Leblanc.
Une question d’intérêt public, selon le CIUSSS
Invités à commenter la décision de la Cour suprême, les avocats de la DPJ ont référé Droit-inc au service des communications du CIUSSS concerné.
Par courriel, l’établissement nous a d’abord mentionné qu’il ne pouvait pas commenter le cas précis d'un enfant pour des raisons de confidentialité. Il a néanmoins confirmé que la démarche visant à obtenir une demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême « concernait une question de droit précise, complètement indépendante du cas spécifique dont il est question dans le jugement de la Cour d'appel du Québec ».
Le CIUSSS souligne que dans son jugement rendu le 22 août 2024, la Cour d'appel mentionne elle-même que la question de droit soulevée par la DPJ était d'intérêt public pour le système de protection de la jeunesse dans son ensemble, et qu’elle dépassait l'intérêt des parties.
« C'est pour cette raison que la DPJ a eu l'autorisation de déposer une demande d'autorisation d'appel devant la Cour d'appel du Québec en janvier 2025 », justifie l’établissement
La demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême avait pour but de bien comprendre les obligations, rôles et responsabilités de la DPJ au sens juridique, explique encore le CIUSSS.
Quant à savoir quels changements amèneront les prochaines décisions des tribunaux en matière de lésion des droits de l’enfant dans les pratiques de la DPJ, « il s'agit d'une question qui devra être réfléchie à plus haut niveau avec l'ensemble des DPJ du Québec », termine l’établissement.
Partager cet article:


 Gmail
Gmail
 Outlook
Outlook