Les maux et les mots

Louise Arbour
2020-10-28 11:15:00

On dit souvent que la culture, c’est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Il me semble que c’est Gilles Vigneault qui avait dit : « La violence, c’est un manque de vocabulaire. » Il me corrigera si j’erre.
Autant le militantisme, provoqué par l’indifférence ou l’intolérance, manque souvent sa cible, autant les positions absolutistes sont sans issues. J’ai mis longtemps à accepter ce que j’avais lu dans un vieux jugement anglais que je n’arrive pas à retrouver, soit que toutes les bonnes choses, même la vérité, la liberté, la justice et la paix, lorsqu’elles sont recherchées avec trop de zèle, peuvent être obtenues à un prix trop élevé (par exemple : chercher la vérité en tentant d’obtenir une confession par la torture, exercer sa liberté de ne pas porter de masque en contaminant les autres, appliquer une peine minimale d’emprisonnement à une personne en fin de vie, capituler sans espoir de survie).
Manque d’empathie
Ce qui me frappe dans le débat actuel (et j’hésite à qualifier de débat ce qui n’est trop souvent qu’un monologue égocentré), c’est le manque d’empathie, c’est-à-dire l’incapacité de voir le monde d’un point de vue autre que le sien. Le point de départ à tout exercice de réconciliation de positions extrêmement opposées consiste à se départir d’absolutismes. Cela s’applique tout autant à la liberté d’expression qu’à la liberté d’enseignement. C’est d’ailleurs là la sagesse, malgré sa difficulté d’application, de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés :
« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
Après avoir abandonné une position rigide et absolue, la deuxième étape demande qu’on s’interroge sur sa propre position : plus nos « valeurs » coïncident avec nos « intérêts » (y compris le maintien d’un statu quo), plus nous devrions mettre en doute notre bonne foi. Et quand notre position est celle de la majorité, plutôt que d’y trouver confort, on devrait se pencher sur les rapports de force et écouter encore plus attentivement les voix des minorités perdantes.
Ce genre de démarche est bien ancré dans la problématique des droits de la personne, droits qui apparaissent souvent irréconciliables, et se retrouve, sans être explicite, dans la réponse du recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, à la controverse entourant l’utilisation du mot en « n » par une professeure. Il n’y a là rien d’étonnant puisqu’il était auparavant président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Il n’y a aussi rien d’étonnant à ce que sa réponse n’ait pas rallié toutes les parties prenantes. Mais il a sûrement raison de dire qu’exercer sa liberté comporte d’en assumer les conséquences, y compris l’expression de la liberté des autres.
Et si les autres s’intéressent moins à nos intentions qu’à leurs sensibilités, c’est aussi leur droit de le dire.
Dans un ordre de grandeur moindre, je me suis débattue, sans beaucoup de succès je l’avoue, pour la féminisation des titres et l’abandon de l’expression « droits de l’homme » dans le cadre de mes fonctions aux Nations unies. Une vieille arrière-garde de la langue française refusait de concéder la nature politique de la langue et du langage. Le refus de reconnaître l’existence du racisme systémique relève de la même attitude. On trouvera probablement un compromis en parlant de discrimination systémique basée sur la race, ce qui permettra de ménager la chèvre et le chou.
Après la chèvre, je saute du coq à l’âne. De tous les arguments avancés de part et d’autre dans ces débats, le moins convaincant est celui qui nous met en garde contre l’acceptation de concepts qui nous viennent des États-Unis ou du Canada anglais. Ce genre de nombrilisme est incompatible avec l’ouverture nécessaire au foisonnement des idées et à l’évolution d’une culture.
À propos de l’autrice
Me Louise Arbour a été juge à la Cour suprême du Canada de 1999 à 2004 et Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de 2004 à 2008. Elle a aussi agi à titre de procureure en chef du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie et de celui pour le Rwanda.


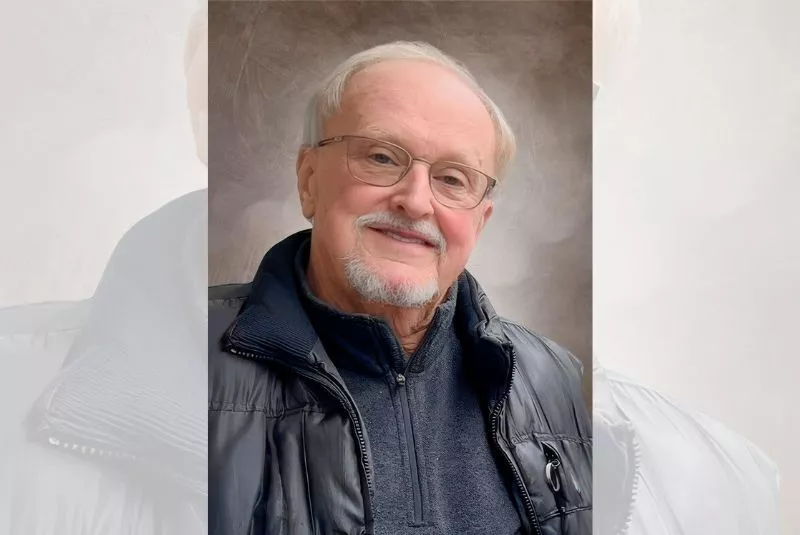






Me
il y a 5 ansUn jour, en 2095, quand la civilisation occidentale dans toute sa grandeur et réussite n'existera plus, qu'on sera au mieux un petit Brésil, on va relire des gens comme Louise Arbour et on va voir que c'est en écoutant ces gens-là qu'on a tout perdu.
Anonyme
il y a 5 ansAvec ces déclarations farfelues qui ont des relents de suprématie raciale! Déclin de la civilisation occidentale ci, déclin de la civilisation occidentale là! Bon sang! Depuis quand le fait de dire "il faut peut être en tant qu'être humain, se prêter à la gymnastique intellectuelle de se mettre à la place des autres de temps en temps?" menace la civilisation occidentale?
Non mais lisez des livres d'histoire qui ne vous narrent pas que les "bienfaits" de votre sacrosainte civilisation et espérons que vous reviendrez de votre trip "on est meilleurs que les autres ou on veut nous exterminer"!
En plus, vous êtes avocat avec des idées pareilles; qu'est-ce que ça aurait été si vous étiez non instruit?
Jaeger-LeCoultre
il y a 5 ansVoici une liste, non exhaustives, des réalisations de la civilisation occidentale
- la démocratie libérale;
- la liberté d'expression;
- la liberté de religion;
- la séparation de l'Église et de l'État;
- l'égalité homme/femme;
Pas si mal comme réalisations, vous ne trouvez pas ?
Me
il y a 5 ansDonc si je comprends bien, vous trouvez que la civilisation occidentale fait du progrès? Que les temps sont meilleurs? (et je ne parle pas de l'épisode Covid).
Qu'on est pas dans une ère asbsurde dans laquelle où toutes les supercheries de la nature sont célébrées au lieu de la famille nucléaire? Qu'on est en train de tourner le coin pour un monde meilleur? Libre à vous!
Moi je crois que la civilisation occidentale est en déclin dû à une trahison des élites. On jette des siècles de lumières pour s'aplaventrir devant des postulats douteux, une foule en délire et une révolution culturelle qui ferait sourir Mao.
La seule différence que ça fait que je sois avocat c'est que je peux piler de l'argent pour minimiser les impacts de cette vague pour ma famille et moi. Mais vous avez raison de souligner le cas des non instruits, ce sont eux les dindons de la farce là-dedans et ce seront, malheureusement, les premiers à souffrir. Regardez le Brésil ou l'Afrique du Sud, je vous dis c'est l'avenir du Canada. Vous êtes en désaccord avec moi, c'est correct, vous avez le droit, je vous donne ma prédiction, c'est tout!
Anonyme
il y a 5 ans- inégalité sociale (même entre blancs purs)
- individualisme au point où le taux de suicide des jeunes est en hausse
- Consommation extrême, nous sommes que des ressources et l'objectif est de consommer, c'est tout... Donc surconsommation, surproduction, réchauffement planétaire....
- On entend sans écouter ce qui provoque une société divisée
- On parle sans discussion, un dialogue de sourd
- On oublie l'histoire (pas la directe mais aussi l'indirecte, la fondamentale...par exemple la démocratie est née dans la région de la méditerranée) Les sciences, la mathématique et le langage écrit viennent de l'afrique et du moyen orient.
- finalement on oublie que nous sommes tous interreliés et dans le même bateau.
Bof, finalement après 60 ans de tentative d'espoir qu'il est clair que nous sommes plus pareil que différent, aujourd'hui je m'en fou que le plus fort gagne en sachant ce que l'histoire enseigne, le plus fort aujourd'hui sera faible demain....Ex. La perse, l'égypte, la turquie, la grèce, rome, la france, l'angleterre, l'espagne, le portugal, bientôt les États-Unis, ensuite possiblement la Chine et ainsi de suite....Bye
Jaeger-LeCoultre
il y a 5 ansDonc les inégalités sociales, l'individualisme, la consommation extrême, etc. sont le propre et sont exclusif à l'Occident ? N'est-ce pas plutôt des caractéristiques propre à l'humain... ?
Dois-je comprendre que vous considérez que les valeurs de démocratie et de liberté, propre à l'Occident, ne sont pas si importante que cela ? Qu'entre l'Arabie Saoudite et la France, les deux s'équivalent, entre autres au niveau des droits humains ? Qu encore, que le régime politique de la Chine est équivalent (voire supérieur) à celui du Canada? Si tel est le cas, je comprends que vous considérez que la Déclaration « universelle » des droits de l'Homme, est un signe de l'impérialisme occidental qui n'a pas sa place dans l'Ordre mondial...
Anonyme
il y a 5 ansBon argument! Le problème c'est l'humain pas le système!
Je vous dis enlever l'humain et tous les systèmes sont parfaits!!! Oui, OUi incluant la dictature, le communisme, etc...
C'est pas justement cela l'évolution, améliorer les systèmes pour répondre aux problèmes de tous les humains!!! Ou, on est fataliste et dire que notre système est correct et au diable les autres et les victimes de celui-ci, puisque c'est normal. La liberté! Point... Si vous êtes ouvert à l'amélioration, vous devez critiquer. Si, par ailleurs, vous pensez que c'est parfait comme cela, je vous souhaite le bonheur parfait...
Pour ce qui est des chartes, des déclarations universelles et tous ces beaux textes très positifs... Je trouve qu'il manque une section des obligations et des responsabilités qui viennent avec les droits et libertés.
Anonyme
il y a 5 ansJe suis d'accord avec le texte de Mme Arbour. Par contre, je reproche au recteur de l'UdO d'avoir sanctionné cette prof sans même lui donné l'opportunité de donner sa version. Hello, Audi alteram partem? Qu'il décide de la sanctionner, soit mais écoutez-la d'abord! Il a confirmé ouvertement et publiquement des pratiques qui sont courantes à l'UdO: un étudiant va se plaindre (en général, ils se livrent) et oups, le prof est coupable, surtout quand c'est un prof à temps partiel. Cette jeune prof n'a pas mérité le traitement que son employeur lui a fait subir. Déjà, la simple teneur de la lettre d'excuses publiée sur Twitter montre des remords sincères, qui auraient dû encore plus inciter l'université à la convoquer pour faire entendre son point de vue. Mais ça n'a pas été le cas et c'est un dangereux message à l'encontre du corps professoral qui a été envoyé!
Quant à l'emploi du mot en N et de tous mots péjoratifs et dégradants similaires résultant de siècles d'oppression et dont les effets se font encore sentir, ils ne devraient être utilisés qu'avec parcimonie, dans un contexte précis, à défaut de ne pas l'être. On peut faire cours, dire la vérité historique sans offenser. Je pense que si tout ce débat tournait autour de l'emploi dans le cadre académique de mots dégradants utilisés pour qualifier les européens ou occidentaux au cours des siècles, on n'aurait ni levée de boucliers, ni besoin de rappeler aux gens de faire preuve d'empathie.
Anonyme
il y a 5 ansEn bonne sophiste, cette ex-cuisinière de la Cour suprème nous sort un bel exemple de faux dilemme, comme s'il y avait un consensus blanc et un consensus noir.
Il y a des noirs qui s'opposent farouchement au regard sur le monde porté à travers les lunettes de BLM. Ils sont étiquettés "faux noir" ou "mauvais noir" par le camp BLM, et les chaines d'informations ne relaient pas leur discours. Ici, ce "faux noir" serait Normand Brathwaite, et on ne l'entend pas à Tout le monde en parle ni à Plus il y a de fous plus on lit.
Le documentaire "What killed Michael Brown", de Shelby Steele (ancien milliant noir qui en connait un rayon sur le sujet), a été retiré du catalogue d'Amazon pour cause de “content quality expectations”.
Les expectatives de qualité d'Amazon logent à l'enseigne du discours victimaire et haineux de BLM, et tout ce qui sort de cette tranjectoire est jugé indésirable, exactement comme à Radio-Canada.
Pirlouit
il y a 5 ansCitation de Louise Arbour reprenant ceux de Frémont : "il a sûrement raison de dire qu’exercer sa liberté comporte d’en assumer les conséquences, y compris l’expression de la liberté des autres".
Bien oui comme le professeur français dont la conséquence est qu'il s'est fait couper la tête parce qu'il a exercé sa liberté d'expression dans un cadre académique ... il doit en assumer les conséquences selon vous ! Vos propos sont une attaque en règle comme la liberté d'expression. La liberté d'expression ce n'est pas seulement avoir le droit de dire quelque chose mais c'est d'en être protégé des conséquences violentes et haineuses. Franchement, que vous arrive-t-il.
Anonyme
il y a 5 ansAlors que les réseaux sociaux ne sont pas loin de censurer les images d'enfants blancs mangeant un cornet de crème glacée à la vanille, en invoquant les "community guidelines" et le combat contre le "suprémacisme blanc", on apprend que:
"Instagram has refused to remove an image depicting two black women holding the severed heads of white people, claiming that “people may express themselves differently” and that the picture doesn’t violate community guidelines."
http://www.rt.com/news/504115-instagram-refuses-remove-black-woman-white-people-severed-heads/
Joseph Facal, qui connait bien les facultés de "science sociales", explique les sources des dérives dans cette branche de la "science":
http://www.journaldemontreal.com/2020/10/29/universites-pourquoi-lintolerance-se-repand
http://www.journaldemontreal.com/2020/10/27/isaac-est-juif